Prochain niveau: 2 EXP

Dans la troisième partie de notre conversation-fleuve, LG et moi causons finalement de plein de choses :
Dans le numéro #18 de juin, Julien Pouard reviendra pour discuter de l’écriture, la rédaction et la publication des scénarios ! Si vous avez des questions sur ce sujet, n’hésitez pas à les poser dans les commentaires (on aime bien les questions, nous).
La deuxième partie de notre longue conversation avec Le Grümph sur le rythme, le découpage, la préparation des parties et l’improvisation généralisée se poursuit notamment à travers :
Comme intermède à notre série d’articles, voici un autre gros podcast découpé en trois belles tranches et enregistré avec Le Grümph. Dans cette longue conversation à bâtons rompus, on cause notamment de rythme et de découpage (tout de même), mais on compare aussi largement nos manière de mener, tout ce que LG improvise et ce que moi je prépare.
Cette première partie aborde donc notamment :
Dans notre série d’articles « Jeter les dés ne me suffit plus » , après l’introduction Pourquoi le gameplay est important puis les trois premières parties Définir le gameplay , Paramètres de gameplay & jouabilité et L’agentivité et le système-monde, voici le quatrième article où on commence à mettre les mains dans le moteur pour causer de game-design…
Cette chasse au gameplay dans la jungle touffue du jeu de rôles est une entreprise de longue haleine : si vous êtes là depuis le début, déjà, je vous en remercie. On a maintenant suivi différentes pistes pour tenter d’identifier l’animal et grimpé quelques hauteurs théoriques pour repérer notre proie : il est presque temps de s’enfoncer dans les sous-bois de la mécanique de jeu pour approcher l’animal.
Mais vu le nombre de notions abordées depuis le début, accordons-nous un petit bivouac explicatif, ne serait-ce pour rassembler notre équipement conceptuel en récapitulant un peu…
En Français, le « jeu » peut désigner deux choses : d’une part l’objet mental et/ou physique avec lequel on joue, et d’autre part le divertissement qu’il génère, l’activité consistant à jouer avec ce jeu. Ça produit un paquet de confusions, mais elles peuvent être assez aisément dissipées si on utilise l’Anglais comme détrompeur, puisque cette langue-là distingue l’objet, « game« , de son utilisation, « play« .
→ Depuis sa parution, j’ai ajouté une note à ce sujet dans le premier article.
Un jeu est de fait une construction essentiellement virtuelle : dans sa plus simple expression, il n’est fait que de règles, des instructions arbitraires conçues pour orienter l’activité vers le fameux but du jeu, donc lui donner un sens, et encadrer l’action des participants.
Ces règles peuvent alors être explicites, transmises aux joueurs pour qu’ils les respectent, ou implicites : dans les jeux plus complexes, elles s’apparentent alors à des mécanismes, des ressorts internes qui assurent le fonctionnement et produisent des effets variés, mais qui ne sont découverts par les joueurs que s’ils y prêtent attention.
Mais une conceptrice de jeu, elle, va même devoir s’aventurer plus loin dans la mécanique virtuelle…
Lorsqu’un jeu atteint une certaine complexité, il nécessite une interface pour être manipulé, parfois physiquement, et s’appuie alors sur divers supports : des pions, des marqueurs, un plateau, des dés, des boutons et un écran, des fiches… et des règles écrites, c’est à dire non seulement explicites mais enregistrées, compilées en texte et peut-être même illustrées pour être plus facilement transmises, apprises et consultées.
Mais les supports matériels, les documents de références et mêmes les règles explicites ne représentent toujours qu’une mise en forme du jeu : une incarnation tangible donnée à un objet qui reste virtuel par essence, qui ne fonctionne que dans nos têtes, parce qu’il y fait sens.
Ainsi, nombre des mécanismes du jeu, les règles et rouages internes qui assurent son fonctionnement, sont le plus souvent mathématiques ou sémantiques : ils reposent sur des nombres (qui peuvent alors être matérialisés sur des cartes, des dés, des fiches…) et sur des mots, composés en phrases dont le sens produit des règles d’interaction, y compris entre les nombres. Par exemple, si un personnage est retiré du jeu quand il tombe à 0 points de vie, l’arithmétique ne suffit pas à produire l’effet : elle assure certes le calcul jusqu’à la valeur 0, mais c’est la sémantique qui indique le résultat, qui signifie la conséquence « alors ce personnage dégage« .
La mécanique des jeux ressemble en cela au code informatique : on emploie un langage pour désigner des conditions, des options et des conséquences, que l’activation par les utilisateurs va déclencher, et dont on va ensuite leur afficher le résultat sous une forme compréhensible par un humain (ce que, de manière intrigante, l’Anglais appelle « display« ).
Là où ça devient quand-même assez tordu, c’est que même le recourt au langage n’implique pas nécessairement qu’un mécanisme sera explicite. Argh.
Ainsi, même quand une règle écrite énonce qu’on peut piocher des ressources jusqu’à épuisement de la réserve, elle ne précise pas nécessairement que l’importance stratégique de la ressource va inciter une ruée des joueurs pour se l’approprier, donc faire l’objet d’une compétition à l’intérieur du jeu.
Cette déduction, comme le choix peut-être laissé aux joueurs de négliger cet aspect-là pour se concentrer sur d’autres ressorts du jeu, appartient déjà au gameplay : l’usage du jeu.
Mais pour reprendre la traque, considérons justement quelques aspects mécaniques…
ÉPREUVE, INCERTITUDE & TENSION LUDIQUE
La mécanique de jeu peut contenir plus ou moins de rouages et produire des effets parfois franchement complexes, ne serait-ce que par l’interaction entre ses différents mécanismes. Mais on peut déjà en isoler un principe, un dispositif ludique si essentiel qu’il est déjà, à sa petite échelle, une représentation de toute la notion de jeu et un condensé de gameplay : une épreuve.
Ce que j’appelle une épreuve ludique (et dont j’ai déjà parlé dans le Carnet Ludographique #2) consiste principalement en trois choses :
● un objectif, qui est l’équivalent ponctuel d’un but du jeu et qui implique généralement un « enjeu », c’est à dire quelque chose à gagner et/ou à perdre,
● une difficulté à atteindre cet objectif, qui suscite justement le challenge, la part de défi qui donne son intérêt au jeu et
● des moyens d’action, disponibles aux joueurs pour tenter de dépasser cette difficulté.
Pour reprendre mon bon vieil exemple des fléchettes, l’objectif y est simplement représenté par la cible et la difficulté par la distance : si on jouait à une longueur de bras de la cible, on aurait même pas à lancer nos fléchettes pour l’atteindre, il n’y aurait pas de challenge et pas d’intérêt. Tout simplement parce qu’on réussirait à tous les coups.
Ce qui fait justement apparaître l’intérêt du challenge : l’incertitude.
C’est bien parce qu’on ne sait pas si on va réussir que le challenge est un défi, une invitation à nous mesurer à la difficulté. C’est ce qui fait dire à l’écrivain et éditeur américain John Ciardi : « Tous les jeux jamais inventés par l’humanité consistent à créer de la difficulté pour le plaisir. », quand Alfred Capus (journaliste assez rassi déjà cité dans le segment Plaisir & difficulté du Radio Rôliste #49) disait : « Je ne joue pas pour gagner ou pour perdre. Je joue pour savoir si je vais gagner ou si je vais perdre. ».
C’est la formulation la plus basique de la tension ludique, qui fait tout l’intérêt de l’épreuve : la crainte de l’échec et pourtant la volonté d’en courir le risque pour pouvoir, peut-être, gagner. C’est cette tension qui retient l’attention des joueurs et qui les mobilise au jeu, qui les engage à jouer et à s’investir.
(Elle aurait d’ailleurs une valeur toute particulière dans les jeux de rôles parce que, si elle est ressentie par les joueurs, elle ouvre en fait la porte à un autre élan émotionnel bien utile aux jeux de narration : la tension dramatique, celle qui attise cette fois votre désir de connaître la suite d’une histoire. Ça aussi, on y reviendra.)
[ LA RÈGLE 0
Il est une intéressante notion de game-design qui veut que, plutôt que d’entasser n’importe quoi sous le capot d’un véhicule ludique, on puisse évaluer la pertinence minimale d’un mécanisme de jeu par le simple fait que la présence de ce mécanisme produise des résultats plus intéressants que l’absence de mécanisme. Ça semble assez évident, j’en conviens, mais ce n’est pourtant pas aussi largement appliqué que ça le devrait et, surtout, ça a une conséquence particulière dans les jeux de narration comme le jeu de rôles : pour que l’histoire avance, le moyen le plus simple de résoudre l’action d’un joueur n’est pas de recourir à la mécanique de jeu, c’est tout connement d’intégrer l’action à la narration.
Vous voulez forcer la porte verrouillée ? Hé ben crac, elle est enfoncée, on peut passer à la suite.
Et si on trouve que ça manque quand-même assez fort de challenge, il suffit alors d’y appliquer des conséquences ludiques et narratives intéressantes : enfoncer la porte relance l’action en attirant les gardes, en déclenchant un piège vicieux ou en s’ouvrant sur une révélation (évidemment) fracassante.
Et si un mécanisme de jeu n’a rien de mieux à offrir que la règle 0, alors il n’est pas seulement inutile, il est encombrant. ]
LE JEU EN ACTION
Une fois suscité l’intérêt des joueurs, le désir d’atteindre l’objectif malgré la difficulté est alors canalisé vers le troisième aspect de notre épreuve ludique : les moyens d’action mis à disposition des joueurs. Et là, si vous avez un peu suivi ce que je raconte depuis le début, vous devriez commencer à repérer les empreintes toutes fraîches de l’animal gameplay…
Ce désir d’agir, excité par la tension ludique, se traduit évidemment par la volonté d’influencer l’issue de l’épreuve : c’est comme ça qu’on relève le défi, c’est comme ça qu’on s’investit, c’est comme ça qu’on peut gagner et donc, à bien des égards, c’est comme ça qu’on joue. Face au défi de la difficulté, c’est à travers ces moyens d’action que se traduit la réponse des joueurs, l’activité du jeu : qu’il s’agisse de lancer de son mieux une fléchette sur une cible, de presser fébrilement les boutons pour détruire un monstre de pixels ou de planifier sa stratégie avant d’abattre ses cartes dans un rire sardonique, c’est bien l’action et même l’effort des joueurs qui suscite l’agentivité et qui met en œuvre le gameplay, qui en fait représente rien moins que leur participation effective au jeu.
Et pour que cette participation ait un sens, pour que le challenge existe et pour que l’action des joueurs présente un intérêt ludique, il est donc indispensable que les joueurs exercent une influence sur le jeu. Il faut qu’ils puissent peser sur le résultats de leurs actions, ne serait-ce qu’en choisissant parmi des options, en calculant ses risques ou en inventant une tactique, en s’évertuant à maîtriser la fléchette ou la manette, en un mot en produisant un effort pour vaincre la difficulté.
C’est tout simplement ce qui justifie l’existence de mécanismes dans le jeu : traduire le pouvoir des joueurs. Alors, pour manifester ce pouvoir de jouer et stimuler l’agentivité des joueurs, le jeu de rôles, ce parangon du système-monde et du libre-arbitre ludique, après plus de 40 ans d’évolution depuis qu’il fut enfanté du wargame, profitant de son extrême virtualité, de son intensité narrative et de son aisance à incorporer les multiples artefacts développés pour le jeu de plateau, le jeu vidéo et les jeux de cartes, pour satisfaire l’exigence revendiquée des rôlistes, par le travail acharné de ses héroïques concepteurs dont les noms et les théories agitent tant de discussion parmi notre communauté, le JdR donc a produit cette merveille d’action ludique qui consiste à jeter les dés pour tirer les résultats au hasard !?!?
Excusez-moi de vous demander pardon mais est-ce que, par hasard, ON SE FOUTRAIT PAS UN PEU DE NOTRE GUEULE, LÀ ?
Et alors là, attention, comprenons-nous bien : je ne rejette pas en bloc la notion de résolution aléatoire, même pas l’idée un peu simpliste de résolution des actions. Il y a non seulement de bons usages de l’aléa en JdR, mais jeter des dés peut produire plein de tension ludique et de mécanismes intéressants quand on décide d’exploiter le principe.
Mais si ‘jeter les dés ne me suffit plus’, mais alors plus du tout, c’est pas seulement passqueuh ça m’énerve moi-perso qu’un #¤%µ& de bout de plastique décide à lui tout seul si mon action en jeu va avoir des conséquences positives, négatives ou -pire encore- pas de conséquences du tout. C’est parce que, en tant que joueur qui voudrait qu’on accorde un peu d’attention à son agentivité, en tant que MJ qui tient à en accorder à ses joueurs, en tant que consommateur qui paye assez cher pour un produit sensément fonctionnel et -occasionnellement- un concepteur de jeux qui trouve effectivement légitime de se sortir les doigts du cul pour tenter de satisfaire la clientèle, je trouve que non seulement les rôlistes mais carrément cette merveille ludique qu’est le jeu de rôle méritent mieux que ça, mieux que « bah jettes un dé, on verra bien si t’y arrives« .
Je trouve même que le jeu de rôle exige mieux que ça. Ne serait-ce que pour se mettre un tantinet en conformité avec toutes ses hautes ambitions.
Mais il ne suffit pas que je m’énerve pour démontrer mon point de vue : quand on veut remettre en question une mécanique, il faut la démonter…
ALÉA SA PERTE
S’il y a de multiples justifications à la prédominance de la résolution aléatoire dans nos mécaniques de jeu, et même si on peut en tirer des mécanismes qui dépassent de très loin l’exigence minimale de la règle 0, se contenter de l’aléa comme principal mécanisme des jeux de rôles, c’est un peu comme de concevoir un circuit de Formule 1 pour le seul usage des voitures à pédales.
Laissez-moi enfoncer le clou -et quelques portes ouvertes- en réponse aux arguments rôlistes qu’on m’oppose le plus à ce sujet (attention, ça va un peu causer de maths)…
→ Si ça vous intéresse, il y a une pleine page Wikipédia sur les probabilités en JdR…
► « Les dés sont la seule vraie source d’incertitude. »
Nope, pas du tout. Les dés font un bon générateur aléatoire, mais un paquet de cartes battues, pierre-papier-ciseaux et autres jeux de comparaisons « plus ou moins au hasard » (car, figurez-vous, il existe des stratégies statistiquement probantes pour gagner à pierre-papier-ciseaux, donc ce n’est plus vraiment du hasard), les osselets, les runes, les jeux d’attritions aux scores constamment réactualisés, le fait de comparer une valeur connue à une valeur cachée ou même l’imprévisibilité des conséquences (voir l’exemple de la porte effectivement enfoncée sur simple demande) sont déjà des facteurs d’incertitude importants.
Par exemple, face à une porte fermée, même s’il est établi qu’elle s’ouvrira pour peu que le personnage ait un score de Force suffisant, le simple fait d’ignorer le seuil de réussite produit déjà l’incertitude et amène la possibilité de l’échec. Si en plus la différence entre ce score du PJ et le seuil de résistance de la porte peut produire des conséquences imprévisibles (la porte cède au premier contact et le PJ est projeté à l’intérieur par l’élan, la porte cède à moitié et il subit des dommages en l’enfonçant…), l’incertitude augmente encore.
Tout ça sans le moindre moteur aléatoire.
Si votre but est de susciter la tenson ludique en générant de l’incertitude, il existe donc des tas de moyens au moins aussi efficaces que les dés, beaucoup plus rapides, bien plus faciles à utiliser (à mesurer, à compiler…) et qui ne nécessitent pas de matériel spécifique (et payant).
L’intérêt d’un générateur aléatoire comme les dés, c’est de produire plus que de l’incertitude : des probabilités d’une part, et d’autres part une gamme de valeurs numériques qu’on peut comparer, additionner, diviser etc. (mais qu’on peut aussi obtenir avec des cartes et quelques autres supports). Si votre mécanique a besoin de quantifier, si elle nécessite l’aléa, dés et cartes sont intéressants.
Et si les cartes peuvent être produites spécifiquement pour l’usage du jeu, et peuvent alors produire des effets beaucoup plus variés, l’avantage des dés c’est qu’on part du principe que tous les rôlistes en ont déjà. Ce qui n’est pas nécessairement exact, mais généralement vrai. Vous les avez payés en plus des jeux, par contre, mais ça n’est pas complètement « un hasard ».
► « Les dés, au moins, ils sont équiprobables. »
C’est pas faux, mais ce n’est absolument pas un critère de qualité mécanique, encore moins de gameplay.
D’un strict point de vue probabiliste, l’intérêt des dés est de produire une plage de résultats raisonnablement équiprobables à chaque lancer. Quels que soient le nombre de jets que vous faîtes ou les résultats précédents (et malgré toutes les croyances qui s’y attachent), à chaque fois que vous refaites rouler les dés, les probabilités de chaque ‘événement‘ (ici l’affichage d’un chiffre spécifique) sont remises à zéro et donc, de fait, équiprobables. Les cartes, elles, n’offriraient ce genre de probabilités que si on les remettait dans le paquet pour les battre consciencieusement après chaque utilisation (rien qu’en le disant, on sent comme ça ferait chier).
Sauf que l’équiprobabilité, sans autre facteur de compensation (gammes de résultats compensés, logarithmes, etc.), implique que vous ayez à chaque jet autant de chances de produire des résultats sans grande significations ludiques ou narratives que des réussites, des échecs, des miracles et des catastrophes (dés qu’on ajoute la notion de réussite et échecs « critiques », très répandue). D’un point de vue ludique et narratif, c’est à dire selon les principaux critères qui devraient mesurer la qualité d’un mécanisme de jeu de rôles, c’est complètement idiot : pourquoi diable devrais-je avoir les mêmes chances de produire un résultat inintéressant qu’un résultat dramatique ?
À force de se baser sur l’équiprobabilité, on aplatit la signification en même temps que les occurrences, et ce n’est plus seulement le jeu qui est aléatoire : la narration le devient aussi.
[ PROBABILITÉS « NARRATIVES » ?
Néanmoins, si ce qui nous intéresse est de produire une norme de résultats aléatoires dont certaines occurrences vont s’écarter nettement pour produire non seulement l’incertitude mais carrément l’espérance, la crainte et la surprise, des dés peuvent le faire avec des tirages aléatoires compensés. En clair : on jette plusieurs dés, on additionne les résultats et les résultats de chaque dé est compensé, aplani par les autres dés.
Au final, on produit une plage de résultats où les valeurs « moyennes » sortent exponentiellement plus souvent que les valeurs « extrêmes ». Par exemple, sur 2d6, vous avez 44,45% « de chances » de faire 6, 7 ou 8 (soit une probabilité de 0,4445, quand on écrit correctement une proba), mais 16,67% de faire 5 ou moins (ou inversement « 10 ou plus ») et seulement 2,78% de faire 2 ou 12.
D’un point de vue plus narratif, c’est donc un jet de dés qui fait « presque toujours les mêmes résultats moyens, mais de grosses surprises de temps en temps » (je vous assomme pas avec la loi normale, et les courbes de distribution dîtes « gaussienne »). Là non plus, les joueurs n’ont toujours pas d’influence réelle sur un challenge particulier mais, d’un coup, ils savent beaucoup mieux à quoi s’attendre et le suspens est non seulement préservé, il est carrément affiné. ]
► « Les probabilités sont un bon moyen d’évaluer ses chances. »
Mmmmmh : c’est discutable. Les probabilités sont un bon moyens d’évaluer les chances qu’un événement spécifique survienne sur un grand nombre d’occurrences, et uniquement dans ce cas. Ça a l’air intuitif, mais c’est malheureusement une confusion : parce qu’elles sont conçues pour évaluer de grand nombres, les proba n’ont aucune signification raisonnable d’un point de vue individuel : ni pour une personne, ni pour une action.
C’est d’ailleurs pour ça qu’on les utilisent en wargame : parce que quand un régiment de 250 arquebusiers ouvre le feu sur 380 hallebardiers, il est utile de savoir combien de ces derniers s’effondrent. Et là, le résultats est effectivement mieux exprimé par une probabilité.
Néanmoins, lectrices et lecteurs, quand vous-mêmes entreprenez quelque chose d’incertain, pensez-vous répondre à un modèle probabiliste ? Ou est-ce que vos réussites et vos échecs ne sont pas mieux expliquées par les efforts que vous déployez, les conditions de l’épreuve, la motivation et le calme, l’instinct, l’entraînement et l’habitude, les jours où vous êtes distraits par autre chose, fatigués ou tout simplement « pas dans votre assiette » ? Ne serait-il pas alors plus logique, c’est à dire non seulement plus intuitif, plus cohérent avec le comportement humain et narrativement plus intéressant de mesurer les chances de réussite d’un perso selon son état du moment et les efforts déployés ?
Et puisqu’il existe plein d’autres mécanismes ludiques pour créer et résoudre l’incertitude, pourquoi continuerait-on de croire que les probabilités sont le meilleur modèle ?
Je crains fort que l’ancienne parenté avec le wargame soit vraiment l’unique argument en faveur de l’approche probabiliste. Mais en réalité, l’intérêt ludique des dés n’est absolument pas statistique : il est émotionnel (je finis de clouer des arguments et j’y reviens).
► « Le joueur a une influence sur leurs jets de dés par les scores de son PJ. »
C’est inexact : le joueur influence indirectement les probabilités de réussite de l’ensemble de ses jets par les scores inscrits sur sa fiche de perso. Mais d’abord il y a d’autres facteurs (difficultés variables, modificateurs ponctuels, actions impossibles sur l’instant…) et même en détaillant les scores sur la fiche, ces probabilités ne peuvent toujours pas évaluer les chances de réussite d’un individu face à un challenge ponctuel, hein : c’est juste pas fait pour ça.
Quand bien même on admettrait l’argument probabiliste, ça ne signifierait toujours pas qu’un joueur a la moindre influence sur un challenge particulier, ni même qu’il exerce une action sur le cours du jeu : simplement, sur la multiplicité des jets de dés à l’échelle d’une campagne, le 18 en Force de son perso va statistiquement produire plus de réussites qu’un 14. C’est tout.
À la limite, le personnage a alors une relative influence (statistique) sur le cours du jeu à grande échelle, mais le joueur lui ? Non. Pourtant c’est bien lui qui compte quand on parle de gameplay et de challenge, c’est bien lui qui est sensé jouer et relever le défi ludique !
Soyons fous, disons pour déconner que les scores du perso représentent une influence du joueur sur ces chances de succès : quand est-ce que le joueur a une influence sur ces scores ? À la création de perso puis, en suite, marginalement, quand il dépense son XP. Autrement dit, dans l’immense majorité des jeux de rôles : entre les parties.
C’est bien pendant les séances que se déroule l’essentiel du jeu, c’est là qu’on fait des choix, c’est là qu’on affronte l’adversité, qu’on gagne, qu’on perd, qu’on risque sa peau, qu’on la sauve ou qu’on y reste… Mais il faudrait donc jouer sans rien pouvoir à ses chances de succès sur le moment ? Sans pouvoir s’efforcer, négocier, risquer ni sacrifier quoique ce soit, bien souvent sans pouvoir faire de choix stratégique ni apprendre à mieux jouer, sans réelle action sur le jeu, en fait, que de lancer des dés ?!?
C’est pas surprenant d’arriver à une déduction aberrante quand on part d’une hypothèse, fausse, certes, mais avouez que « le joueur n’a d’influence sur ses actions qu’en dehors des séances de jeu« , ça se pose un peu là comme contradiction au gameplay ! Vous imaginez l’engouement pour le wargame ou les jeux de cartes à collectionner si vous pouviez seulement y constituer votre armée ou votre deck, et qu’un moteur aléatoire décidait ensuite du résultat de la partie ?
Mais il est une analogie encore plus frappante. Prenez notre cher RPG vidéo : créez votre perso, baladez vous un peu, équipez-le proprement, optimisez votre tactique par défaut, acceptez une quête… Vous y êtes ? Hé bien maintenant, lâchez la manette : vous répondez juste aux dialogues, le moteur aléatoire se charge de la suite.
Voilà en gros ce que nombre de JdR analogiques vous proposent pourtant comme gameplay.
► « Le joueurs influence ses chances de réussite par les modificateurs appliqués à ses actions. »
Ça se réchauffe, mais c’est encore assez faux (désolé).
Pour que des modificateurs manifestent l’influence du joueur, il faudrait que ce soit lui qui les choisissent : malheureusement pour cet argument, dans la très grande majorité des JdR, les éventuels modificateurs aux dés sont accordés par Madame la MJ, selon son arbitrage, qui est peut-être très juste (ou pas du tout) mais qui n’est toujours pas une influence exercée par le joueur.
Pour mettre en œuvre une véritable influence du joueur sur ces fameux modificateurs, il faudrait déjà qu’ils les connaissent tous et qu’il les comprennent clairement (c’est ce qui s’appelle un choix informé). Après quoi il faut encore qu’il puisse, de lui-même, choisir d’entreprendre une action selon des critères précis pour modifier de manière fiable ses chances de succès. Enfin, il faudrait que ces critères multiples, connus et choisis par le joueur, couvre la plus large gamme possible d’actions.
Je vous la fait courte : d’ici qu’on vende les bouquins de JdR avec un manuel de modificateurs à l’usage des joueurs (plein de facteurs, plein de critères auxquels se conformer, pour la plupart des actions possibles), cet argument est invalide en l’état.
Il peut commencer à faire vaguement sens si, par contre, comme chez certains théoriciens « forgiens », on considère que la MJ est incluse dans le système : qu’elle en est un élément quasi-mécanique, un arbitre objectif qui puisse constamment évaluer les variations de chances de succès pour chaque manière d’entreprendre une action. Ah.
Je serais tenté de lui proposer le manuel des modificateurs suscités, mais on va encore m’opposer le « bon sens ». Premièrement, le « bon sens » n’est pas une règle du jeu : c’est une perception plus ou moins communément acceptée de la réalité du monde (virtuel, mais avec le monde réel comme référent principal : les lois physiques, les interactions humaines, etc.). Mais ensuite, une MJ peut elle avoir une perception objective du système-monde tout entier pour évaluer les facteurs influençant toutes une gamme d’action souvent aventureuse dont, justement, la plupart des rôlistes n’ont pas d’expérience directe ?
Déjà, quand on voit les débats à rallonge sur le combat médiéval en armure, on peut se dire que l’objectivité va être dure à trouver rien que pour ce genre d’actions. Si ensuite on tente de l’appliquer à la furtivité (Qu’est-ce qui fait le plus de bruit quand on marche : les chaussures qui frottent ou les planchers qui grincent ? Est-ce qu’on voit mieux la nuit quand on tient une torche ou quand on évite d’être ébloui ?), aux relations interpersonnelles (trouvez-moi quelqu’un qui ait une vision objective de la chose et on en reparle), aux chances de sauter d’un cheval sur un carrosse en marche ou au tir de torpille, ce n’est plus une MJ qu’il vous faut, c’est les Mythbusters. (Mais on y reviendra.)
Notez qu’alors le pouvoir décisionnel du pauvre joueur par rapport aux experts serait assez réduit, hein. C’est une raison de plus d’arrêter de penser le JdR comme un jeu de simulation, et la raison pour laquelle tous les participants doivent pouvoir se référer à des règles communes : c’est l’unique moyen de tous jouer à la même chose.
► « Mais les jeux de hasard ont bien un gameplay ! »
Ben non, puisqu’ils ne permettent pas aux joueurs d’influencer l’issue : à la place du gameplay, ils ont du hasard (d’où le nom).
Prenons l’exemple du Bingo.
On commence par y choisir, complètement au pif, des chiffres qui nous plaisent : comme dans toutes les loteries, c’est vraiment l’unique critère car, si le « tirage au sort » n’est pas truqué et que le mélangeur est équilibré, la sélection de n’importe quel numéro est au départ équiprobable (tiens, le revoilà lui). Passé le premier tirage, ça change un peu, puisqu’à chaque tirage, l’exclusion du numéro sorti augmente marginalement mais équitablement les proba sur tous les numéros restants. Mais c’est la seule variable de probabilité : au Bingo comme dans tous les jeux de hasard, il n’y a pas de martingale, pas de choix tactique, pas même de choix vaguement rationnel à faire : tous les chiffres se valent.
Passé ce choix au pif, l’influence des joueurs est telle que vous pourriez quitter la pièce pour ne revenir qu’à la fin de la séance de tirage, vos chances de gagner seraient exactement les mêmes. Je ne sais pas quelle meilleure démonstration on pourrait faire de l’absence totale d’influence d’un joueur sur le cours d’un jeu, le déni total de son agentivité, que de vérifier que l’absence même du joueur ne change rien aux résultats du jeu !
Pourtant, des gens y jouent. Plein de gens. Suffisamment pour que la Française des Jeux fasse dans les 12 milliards d’Euros de chiffre d’affaire annuel, et 159 millions de bénéfices en 2015 (ah ça, c’est autre chose que les ventes de JdR !).
Il y a donc forcément une raison pour laquelle les jeux de hasard procurent du divertissement, et même une forme de plaisir qui peut aller jusqu’à l’addiction : c’est en fait la même raison pour laquelle on aime tellement jeter les dés. Mais elle n’a rien à voir avec le gameplay ou l’agentivité, c’est même complètement l’inverse…
► « Mais moi, j’aime jeter les dés ! »
Croyez-le ou non : moi aussi. Dire que ça ne me « suffit plus » ne signifie pas que je n’aime plus le faire, simplement que je veux autre chose en plus (du gameplay et de l’agentivité, donc).
Et si tout le monde n’a pas le même degré de sensibilité au roulement du plastique sur la table en formica, le bruit, le mouvement, les couleurs, l’agitation, l’attente et, soudain, la révélation, ça nous excite tous un minimum. Dans la plupart des cas, ça nous excite même un maximum. Certaines personnes en oublient l’heure et, s’il leur est permis de parier, ils y laisseraient leur chemise, leur bagnole et plus encore.
Car si le jet de dés est très insuffisant pour produire un gameplay, le roulement des dés est, lui, une splendide incarnation sensorielle de la tension ludique : parce qu’ils roulent et cognent comme de petits tambours avant une exécution miniature en place de Grève, parce qu’on y peut plus rien une fois les dés jetés (« Alea jacta est !« ) et parce que ça prend juste assez de temps pour qu’on se tende comme une corde d’arc elfique dans l’attente du résultat, salvateur ou fatal. Pendant que les dés roulent, tout se joue, tout est joué, rien ne va plus, tout est possible : c’est fascinant. Et comme on ne peut plus rien faire, rien n’a plus d’importance que de scruter les polygones de plastique jusqu’à l’arrêt complet du véhicule de tension ludique, qui délivrera la sentence attendue.
Le roulement des dés, c’est du suspens cristallisé !
C’est même pas la peine de s’emmerder avec les puissants processus psychologiques en jeu, il n’y a que la poésie pour rendre justice au phénomène.
De là tous les mythes, les croyances rôlistes sur la chance et la malchance, le destin vengeur et même l’importance esthétique des dés, le fait de s’acheter les siens propres parce qu’on les trouve beaux, qu’on veut les posséder, tenir notre destin au creux de la main.
Et si l’impact émotionnel est bien le seul argument valide en faveur de la résolution aléatoire, fort peu de concepteurs et de joueurs sont prêts à ce passer de cette fascination là.
Coup de bol (haha !), on est pas obligés : avant même de s’aventurer hors de la zone de confort de la résolution (vers la modélisation, par exemple) et sans même lâcher notre précieux aléa comme source d’incertitude, il y a déjà des tas de choses à faire avec la résolution semi-aléatoire…
Enfin, pour autant qu’on comprenne vraiment à quoi et comment on joue au jeu de rôles. Parce que depuis le temps qu’on le traque, on devrait commencer à se demande Où se cache le gameplay du Jeu de Rôles ?
Dans notre série d’articles « Jeter les dés ne me suffit plus » , après l’introduction Pourquoi le gameplay est important puis les deux premières parties Définir le gameplay et Paramètres de gameplay & jouabilité, voici maintenant…
Avant de continuer ma chasse au gameplay dans la jungle touffue du jeu de rôle, je vous invite à m’accompagner un moment dans un détour par deux collines conceptuelles, qui ont l’avantage d’offrir un assez large point de vue sur quelques notions utiles. En tentant de repérer notre proie depuis ces hauteurs, on pourrait aussi apercevoir quelques autres bestioles étranges et même un certain dinosaure de la théorie rôliste…
« AGENTIVITÉ »
Qu’est-ce que c’est encore que ce machin ?
Hé bien c’est la traduction la plus généralement admise de la notion anglophone de « player agency« , qui se répand doucement chez les rôlistes français (vous pouvez notamment prêter l’oreille au podcast des Voix d’Altaride sur ce sujet ou lire ce court article de Hack & Slash, très synthétique mais en Anglais).
Si l’agentivité a des ramifications quasi-métaphysiques quant à la perception du monde (virtuel) et l’auto-détermination des êtres (!), on pourrait la résumer assez efficacement à l’impression des joueurs d’exercer une influence sur l’environnement du jeu.
En jeu vidéo, on dit volontiers que « l’agentivité consiste en la sensation d’une interaction significative avec le monde virtuel » (« gameworld » en Anglais) : c’est le sentiment que nos actions ont une importance justement parce que leurs conséquences font sens dans l’univers du jeu.
L’agentivité est donc d’abord une aspiration des concepteurs et, quand ça marche, une importante satisfaction donnée aux joueurs : on s’investit et on ‘s’immerge’ dans un monde virtuel parce qu’on y croit, et on y croit parce que lorsqu’on interagit avec ce monde, il nous répond d’une manière non seulement cohérente mais qui démontre notre influence sur ce monde.
Si je vous en parle ici, c’est parce que cette impression d’influencer un monde par l’interaction, donc le jeu, va nous apporter un paquet d’éléments pour causer de gameplay en JdR. À commencer donc par un idéal, un effet que les concepteurs cherchent à avoir sur leur public, donc un objectif global pour la conception de jeu qui pourrait même servir à évaluer la qualité finale d’un design.
La notion d’agentivité peut d’ailleurs s’appliquer à pas mal de jeux, mais c’est à partir des RPG vidéo qu’elle a été développée et, vue l’importance qu’elle donne à l’interaction avec un monde virtuel, c’est bien en jeu de rôles qu’elle est la plus pertinente, sur table comme sur ordinateur. Dans les deux cas, elle met tout particulièrement en valeur deux notions fondamentales du JdR : le système et l’histoire…
[ SYSTÈME OU MÉCANIQUE ?
Puisqu’on en est à définir des termes, penchons-nous un instant sur la distinction entre ‘système de jeu‘ et ‘mécanique de jeu‘.
Si j’insiste personnellement pour parler de Mécanique, c’est parce que le mot évoque naturellement l’effet de levier que je veux proposer à mes joueurs : l’un deux pousse une manette (jette des dés, mise des pions, tire une carte…), ça fait tourner le « moteur » et ça produit un résultat. C’est une machine toute entière faite de règles, de chiffres et de mots mais ce n’est pas un hasard si on parle souvent de ‘moteur de résolution’ ou de ‘mécanisme d’expérience’ : c’est parce que l’approche mécaniste du game-design se focalise justement le fait de produire un engin fonctionnel, avec lequel les joueurs puissent interagir de manière intéressante (qu’il serve à produire du drame poignant ou à décaniller du gobelin).
La notion de Système, elle, est bien plus vaste, particulièrement dans son acception « forgienne » : elle englobe à la fois la mécanique et le gameplay, le roleplay, les tâches du MJ, les pouvoirs des joueurs, le paradigme de l’univers fictif et, finalement, presque tout ce qui participe à définir le fonctionnement global du jeu où s’immerge les joueurs, selon les intentions de l’auteur.
Par facilité, j’emploierai donc « Mécanique » quand je parle des rouages internes et des leviers accessibles aux joueurs, et « Système » quand je fais référence à l’ensemble du cadre ludo-narratif. ]
LE SYSTÉME-MONDE
On décrit souvent les RPG vidéo comme des jeux « system based« , c’est à dire qu’ils sont construits sur un ensemble de mécanismes -le fameux système- qui assure la cohérence du terrain de jeu d’une part, et codifie d’autre part ce que les joueurs peuvent y faire. Vous me direz : c’est en fait vrai d’énormément de jeux vidéo, et de nombre de jeux ‘tout court’.
Mais ce que l’expression souligne en fait, c’est que le système des RPG à une valeur qui dépasse de loin le simple fait de coder et de permettre le jeu : le système est l’essentiel du jeu.
Il n’est pas qu’un moyen de cadrer le monde virtuel, il sert à lui donner corps, à lui donner du sens. L’intérêt du jeu repose justement sur l’exploration du système-monde, cette découverte informe très largement la manière dont on joue et c’est la compréhension des interactions mécaniques au sein du système qui (comme dans les jeux de stratégie) va y déterminer la performance d’un joueur.
C’est, en peu de mots, un système où la cohérence du gameplay assure la crédibilité de l’univers virtuel.
Pour prendre un exemple concret, jouer à un RPG vidéo comme The Witcher 3 implique justement d’explorer et comprendre le fonctionnement du monde. C’est avant tout en s’y baladant qu’on découvre les lieux, les terrains, les marchands, les monstres, les trésors et les quêtes, c’est en explorant qu’on acquiert peu à peu les principes du combat (l’armement, la magie, la tactique, le niveau des ennemis…), de l’artisanat (les armes, les armures, les potions, les bombes…) puis qu’on découvre des « lieux de pouvoirs » pour booster sa magie etc.
Tous ces mécanismes interagissent déjà largement pour enrichir le combat, qui reste la mécanique la plus développée de tout le jeu et l’essentiel du gameplay (comme de l’immense majorité des RPG vidéo, voire des JdR). Mais c’est bien parce que les broussailles prennent feu quand je projette des flammes et que la gravité fait retomber mes projectiles vers le sol que j’arrive à croire à ce monde, donc à y investir d’abord ma réflexion (pour tenter de comprendre comment tout ça fonctionne), puis mes émotions primaires lorsque je suis effrayé par une saloperie mutante ou ravi d’avoir eu le dessus sur des brigands, et finalement que le système-monde suscite chez moi des sentiments plus complexe pour m’apitoyer sur le sort des paysans affamés par la guerre.
[ SYSTEM-WHAT ?
En Anglais, l’expression « system based » est employée dans bien d’autres domaines que le game-design (santé, sécurité, évolution biologique…) et décrit généralement l’approche « holistique« d’un domaine : le fait de traiter ce domaine comme un tout, supérieur à la somme de ses parties, et généralement caractérisé par un ensemble de paramètres en interactions les uns avec les autres. ]
LE SYSTÈME-HISTOIRE
Et c’est là que gameplay et agentivité se rejoignent au pied de la narration. Parce que, au-delà des principes mécaniques du système-monde, le fait que mes actions aient des conséquences cohérentes dans l’univers et que j’y trouve un sens va commencer à produire des histoires.
Par exemple, jouant maintenant à Fallout, si je mitraille un pauvre zombie au bord d’une rivière, ce n’est qu’un petit événement sans grande signification et donc au mieux une petite victoire. Si maintenant ce zombie est né du trépas d’un marchand itinérant dans une source d’eau radioactive et que, après l’avoir meulé, je découvre sur lui les indices du dernier bivouac où il a laissé sa carriole pleine de la ressource rare qu’il transportait, je vais être incité à remonter la rivière pour retrouver le trésor : le système-monde vient d’établir une logique spatiale (ce qui se passe à un endroit a des conséquences dans les environs) et temporelle (une causalité, des événements antérieurs à ma présence…).
Ce serait absolument évident dans le monde réel, puisqu’il fonctionne comme ça par nature et que les gens en ont pris l’habitude. Mais dans un monde virtuel, ça dénote déjà un effort de conception et ça crédibilise le système-monde : non les ressources exotiques n’apparaissent pas par magie dans les boutiques, oui ceux qui les colportent utilisent des carrioles et campent près des sources, oui il leur arrive des tuiles en chemin et donc, si tout ça est bien logique, il doit même y avoir une raison pour que la source soit radioactive et que le gus y soit mort. Tiens, d’ailleurs, qu’est-ce que c’est que ces empreintes étranges au bord de l’eau ?
Sans m’en rendre forcément compte, depuis un moment, je n’interagis déjà plus seulement avec le système-monde : j’interviens dans l’histoire. L’histoire du pauvre colporteur, qui a précédé mon irruption, et maintenant l’histoire de ma recherche du butin et de mon enquête sur le mystère de la source. Alors, si tout le bousin continue de se montrer cohérent, mon impression de comprendre le système-monde va se doubler du sentiment d’influencer le récit, et donc mon agentivité devient narrative.
Tatatiiin !
Ce n’est donc pas seulement grâce à la qualité des scénarios et de leur narration (l’écriture, les dialogues, le jeu d’acteur, la mise en scène…) que je peux m’investir dans les histoires que raconte cet univers virtuel, que j’ai envie de m’en mêler et d’en découvrir la suite. C’est parce qu’on a commencé par suspendre très haut mon incrédulité en me démontrant que je faisais effectivement des vagues en marchant dans l’eau et que je pouvais découvrir du butin si je me préoccupais de la logique du monde : plus mes flammes magiques carbonisent les buissons, plus la radioactivité me contamine graduellement, mieux je crois au paysan qui crève la dalle dans The Witcher ou au colporteur malchanceux de Fallout.
[ SUSPENSION D’INCRÉDULITÉ
En dramaturgie et autre narratologie, la suspension d’incrédulité est le fait qu’on admette la logique interne d’un récit pour en profiter : parce que si on se demande pourquoi les canon-lasers font du bruit dans le vide spatial pendant qu’on regarde Star Wars, on se gâche le film. Donc on admet que les lasers font du bruit pasqueuh c’est comme ça dans l’histoire, et que c’est cool.
Pour certains théoriciens, cette acceptation du paradigme du récit est un acte volontaire du public, quoique pas forcément conscient : notre culture a simplement pris l’habitude qu’on lui raconte des histoires, et d’arrêter de gamberger pour les apprécier. Mais, comme la plupart des scénaristes vous le diront, la suspension d’incrédulité nécessite en fait que les auteurs y travaillent : qu’ils donnent une valeur narrative au paradigme qu’ils instaurent (on accepte un élément parce qu’il ajoute de l’intérêt au récit) et qu’ils en maintiennent la cohérence (on continue d’y croire parce que ça fait sens dans ce monde-là).
Le concept a d’ailleurs une fonction particulière en jeu vidéo puisque, pour interagir logiquement avec le monde virtuel, il faut déjà qu’on adhère à sa représentation multi-média malgré ses limites. Pour jouer, on doit donc accepter de considérer tel ensemble de polygones comme ‘un arbre’ ou qu’un portrait et un peu de texte constitue ‘un personnage’. Sans cela, le monde virtuel n’a plus de sens et on ne peut pas y interagir. ]
Quand ces jeux sont à leur meilleur (c’est à dire pas toujours, mais c’est pas grave), ils peuvent alors m’offrir des choix vraiment significatifs : choisir un camp, trancher un différent, décider à qui je fais confiance et qui je vais trahir, sacrifier quelqu’un pour mon gain personnel ou pour sauver une communauté. Des choix qui vont faire sens justement parce qu’ils sont premièrement informés par ma compréhension du système-monde et deuxièmement qu’ils y ont des conséquences crédibles : le criminel que j’ai démasqué finit pendu, l’eau assainie de la source permet aux fermes voisines de revivre, je peux rendre visite à la veuve du colporteur…
Lorsque le système-monde me permet ainsi de décider pour autrui, d’être parfois l’ami ou le juge (et le bourreau) des PNJ puis d’en constater les conséquences, mon agentivité n’est plus seulement physique (pousser les objets, cramer les broussailles) ni strictement narrative, elle atteint à un stade d’investissement encore supérieur : elle prend une dimension morale. Je ne suis plus simplement une « vraie personne » à l’intérieur du système-monde, j’y suis un adulte : j’y pèse mes choix et j’en prends la responsabilité.
Rien ne m’empêche en théorie d’y être un criminel ou un vrai connard, notez bien. Mais le système-monde devrait alors se charger de m’en renvoyer l’image, validant d’une certaine manière mon choix d’être immoral : tant que les vieilles crachent sur mon passage et que les gardes me menacent parce que j’ai buté un innocent, je peux continuer de ressentir mon agentivité.
Au fil des quêtes, de mon exploration et de la montée en puissance de mon protagoniste, l’univers devrait peu à peu me révéler ses secrets : les rapports de force ou d’alliance entre les puissants et les conspirateurs, les relations avec et entre les PNJ, la grande Histoire enfouie sous les petites tragédies individuelles… Car si tout ça est vraiment cohérent dans le système-monde, alors je devrais pouvoir y découvrir les interactions mécaniques régissant l’histoire passée du monde, sa politique et l’affrontement des factions.
Et si la mécanique de jeu est assez développée pour me permettre d’accéder à ce niveau d’interaction, en comprenant comment tout ça fonctionne et en poussant de la bonne manière sur les bons leviers, je devrais carrément pouvoir influencer la marche du monde, donc le cours des guerres ou la renaissance du désert radioactif.
C’est ce qu’essayent de produire des RPG comme Dragon Age : Inquisition, Skyrim ou Mass Effect (avec plus ou moins de succès, déjà), et c’est là que pèchent Fallout ou The Witcher 3, quoique de manière aussi logique que révélatrice…
AUX FRONTIÈRES DU SYSTÈME-MONDE
Je dis que certains RPG (la plupart, en fait) pèchent logiquement à permettre au protagoniste d’y influencer la marche du monde parce que, justement, un environnement informatique est strictement limité par la quantité de mécanismes qu’on arrive à concevoir, à y coder et à y faire interagir sur nos ordinateurs sans que ça bugue trop. Et, à un moment, on atteint aux limites techniques de l’interactivité, qu’il s’agisse de ce que la machine peut gérer ou de ce que les concepteurs ont pu formaliser.
Alors, même si la fiction du jeu me propose de servir d’intermédiaire entre factions rivales, si je peux assainir des villages pour qu’ils soient repeuplés ou décimer les soldats d’un camp (sans déconner : vu le charnier qu’on laisse derrière nous dans la plupart des RPG, ça devrait commencer à avoir un impact à l’échelon stratégique), si on m’offre carrément de participer à l’assassinat d’un gouvernant ou à l’élection d’un autre, la plupart du temps, les lignes de front ne bronchent pas, le désert radioactif ne renaît pas et je découvre assez vite des frontières infranchissables à la galaxie que j’explore (que voilà un intriguant phénomène astrophysique). C’est une simple question de focalisation du gameplay : le RPG vidéo proposant une quantité ‘finie’ d’interactions, il ne peut pas tout faire et dévoue l’essentiel de ses mécanismes aux actions que les joueurs pratiqueront le plus, soit généralement, meuler des ennemis. Le jeu se consacre prioritairement à la variété, à la cohérence et même parfois à la profondeur de ce qui est son ‘cœur ludique’, le noyau de son gameplay (ce qu’on appelle justement le « core-gameplay« ) et, plus je m’éloigne géographiquement, politiquement, stratégiquement ou économiquement du ‘centre de gravité’ commun au gameplay et au système-monde, moins l’univers réagit à mes actions. Et quand je touche les bords du jeu, le monde qui existe en son sein cesse tout simplement d’être interactif, voire cesse d’être tout court.
Ces limites peuvent être simplement acceptées (et oubliées au bénéfice de la suspension d’incrédulité) comme elles peuvent être plus ou moins habilement camouflées par l’habillage du jeu ou quelques mécanismes spécifiques, mais elle nous amène à considérer un autre aspect de notre chère notion : parce que c’est une impression suscitée par le système-monde, l’agentivité peut parfaitement être illusoire.
Dis comme ça, ça a l’air vachement dommage mais, en réalité, l’illusion n’est pas une mauvaise chose dans le domaine du virtuel, puisque c’est son principe essentiel : c’est la base de la narration (d’où la nécessaire suspension d’incrédulité) comme de la représentation multi-média du monde, et c’est encore ce qui donne du sens à une large part du gameplay en général (qu’il s’agisse d’admettre une règle arbitraire pour pouvoir jouer ou de considérer des pions en carton comme des régiments en marche).
Toutes ces fantasmagories ont évidemment leurs limites et la qualité de l’illusion dépend notamment de l’habileté avec laquelle on en camoufle les bords : dans le cas des RPG vidéos, les joueurs qui atteignent la lisière de l’interactivité seront plus disposé à « jouer le jeu » de l’illusion si les concepteurs ont fait quelques efforts d’habillage, qu’il s’agisse d’un texte d’ambiance nous incitant à faire demi-tour plutôt que de nous manger le bord invisible du monde, ou si quelques PNJ commentent les événements à grandes échelles que nous avons sensément influencés (mais dont ces commentaires seront la seule conséquence perceptible dans le jeu).
Que le camouflage soit efficace ou purement symbolique (rendant un hommage un peu vain à notre agentivité, comme on accorde une flatterie au souverain impuissant), notre bonne volonté à suspendre notre incrédulité -donc notre investissement dans le monde- dépendront principalement de ce que le noyau du système-monde et le point focal de sa fiction nous intéressent effectivement, et que le reste de l’illusion aie l’air aussi crédible qu’engageant : alors, comme au cinoche, on peut oublier que l’écran a des bords pour profiter de l’expérience…
SYSTÈME-NARRATION ?
Au-delà de mon exemple autour des RPG (je leur ai pas consacré des centaines d’heure de ma vie pour me priver de les rentabiliser ensuite), ce fameux investissement émotionnel né de l’interaction avec un univers cohérent est le sel particulier des jeux « sandbox » et, pour nous rôlistes, c’est évidemment un principe essentiel de nos JdR sur table.
D’ailleurs, c’est aussi comme ça que la notion de « simulation » du modèle GNS de Ron Edwards a évolué vers la notion « d’exploration » dans son développement en un ‘Big Model‘ : le mec s’est aperçu que la simulation n’avait effectivement d’intérêt rôliste que parce qu’on l’explorait (et sur ce mugissement, le dinosaure retourna dans les frondaisons de la théorie rôliste).
Et puisque cette exploration se produit dans la durée et qu’elle adopte donc une certaine chronologie, elle va -plus ou moins volontairement- produire un récit : une histoire elle-même à peu près aussi cohérente que son système-monde, avec en tous cas un début, un développement et probablement une fin, l’enchaînement de l’ensemble dans l’esprit des joueurs produisant une espèce de syntaxe [soit l’ordre des mots, ou des idées], et donc du sens.
Les deux principaux supports de jeux de rôles que sont l’ordinateur et la table de salon ont ainsi accordé de plus en plus d’importance à l’espèce de récit que génère presque naturellement l’exploration d’un système-monde. Au fil de leurs évolutions respectives (mais reliées, puisque les deux industries s’échangent des concepteurs, des théories et du contenu), JdR sur table et RPG vidéo ont donc commencé à considérer les histoires qu’on peut raconter sciemment au sein de leurs univers fictif.
Tu veux pas dire « univers virtuel », là ?
Non, je fais exprès de glisser vers « fictif ».
Parce que si, dans les cas du jeu vidéo, on cause bien d’un univers imaginaire modélisé par ordinateur, la modélisation du JdR sur table, elle, passe essentiellement par la narration. Plus exactement, elle passe par ce que les universitaires appelle la « parole performative » [version courte : des trucs arrivent parce qu’on les raconte].
Sur table encore plus que sur ordinateur, les univers de jeu de rôles sont fondamentalement fictifs, c’est à dire tout à la fois largement composés de fiction, eux-mêmes supports de fiction et finalement générateurs de fiction. Et si la fiction est à la fois le matériau, le sujet et le produit de ces jeux, par convention autant que pour décrire l’acte principal par lequel on y joue, on parle plus volontiers de jeux « de narration ».
De ce point de vue, on peut aujourd’hui affirmer sans se faire huer que le JdR sur table a cessé d’être un jeu « de simulation » (comme son grand-papy le wargame) pour devenir largement un jeu « de narration ». Ce n’est évidemment pas sa seule valeur, des manières de jouer très diverses coexistent en JdR mais, en plus d’y jouer au sein d’une histoire, on peut maintenant jouer carrément sur l’histoire, les rôlistes s’ouvrant peu à peu à l’idée d’influencer directement la narration : négocier les pouvoirs narratifs, être tous co-scénaristes du récit final et même flirter avec le storygame (dont le principe est justement de jouer à construire un récit, en coopération ou en compétition).
Ceci dit, revenons à nos moutons, enfin : à notre animal conceptuel rôliste…
L’agentivité prend une valeur assez particulière dans les jeux « de narration », parce que si la crédibilité d’une histoire repose elle aussi sur sa cohérence, l’intérêt d’une histoire interactive va alors largement dépendre de l’impression de pouvoir non seulement influencer les événements dans le système-monde, mais aussi de pouvoir en modifier le récit. Autrement dit, si on me propose non plus un système-monde qui produit de l’histoire mais bien une narration interactive, mon agentivité réclame en fait que je puisse modifier le cours de l’histoire jusqu’à la narration, c’est à dire la manière dont cette histoire est racontée.
Expliquons un peu ce truc-là…
Je joue avec une histoire : je la triture, j’y fais des choix, je la modifie. Bon. Mais cette histoire est effectivement transmise par toute une gamme de procédés narratifs (que j’ai déjà pas mal abordés dans les Carnets #12 et #13) : une focalisation et même un cadrage, un certain montage et un rythme qui en modifient la syntaxe, mais aussi un ton, un phrasé et un lexique descriptif qui participe du style, des mouvements de dissimulation puis de révélation qui génèrent la tension dramatique et tout le reste des effets de mise en scène et de réalisation effective durant la séance.
Si, en jouant avec l’histoire, j’en modifie le contenu, c’est à dire le cours des événements et le sens final, toute cette mise en forme narrative devrait nécessairement s’adapter à ces changements : au minimum pour que le fond et la forme de la fiction restent cohérents, mais de préférence pour soutenir et mettre en valeur les aspects de la fiction que le jeu modifie. Par exemple, en cas de conflit, la description finale (ou la cinématique en jeu vidéo) sera très différente selon que j’ai gagné ou perdu l’affrontement : le ton, la mise en scène etc. reflèteront le sentiment de la victoire ou de la défaite.
Mettons maintenant que le gameplay me permette d’entreprendre des actions très différentes, par exemple d’enquêter à partir d’un village, soit en suivant la piste du coupable à travers une zone accidentée et pleine de monstres (méthode préférée de The Witcher 3), soit en visitant le bled pour interroger plein de gens. Selon l’option choisie, l’importance ludique et narrative de mes déplacements changera du tout au tout : dans le premier cas c’est l’enjeu principal (j’enquête par le déplacement), dans le second c’est une perte de temps (j’enquête en causant aux gens, le trajet entre eux est a priori sans intérêt pour l’affaire).
Dans ce second cas, la narration devrait donc enchaîner les ellipses et les dialogues pour concentrer mon attention sur les gens… ce qu’on fait volontiers -car aisément- en JdR sur table, et pratiquement jamais en jeu vidéo (ce qui est d’autant plus curieux que le médium s’y prêterait très bien : c’est un effet de montage).
Si j’ai en plus vraiment beaucoup de gens à interroger, on pourrait même aller jusqu’à résumer tout ça : m’épargner le discours direct et la succession des PNJ qui n’ont rien vu, traités comme une action de recherche globale exprimée par une description générale (mais qui peut déjà faire l’objet d’un petit challenge et où peuvent apparaître l’attitude des villageois, des opinions sur l’affaire…), afin de mieux ralentir et zoomer ensuite sur les villageois qui ont effectivement quelque chose à raconter (et me proposer alors un gameplay détaillé pour les amener à parler, évaluer leur sincérité, extirper l’information du recoupement de leurs témoignages…).
La mise en scène de cette enquête serait ainsi cohérente avec l’histoire et le gameplay de mes interactions avec les villageois : si on m’en laisse la liberté, mon agentivité dans l’histoire s’étend logiquement jusqu’à la narration.
En la matière, la limite du jeu vidéo est encore essentiellement technique : pour ainsi moduler la narration, le médium devrait pouvoir identifier certaines caractéristiques de l’histoire, y compris le sens et le ton, pour adapter la mise en scène. Et sans un cerveau humain pour gérer ces subtilités-là, le logiciel se borne encore à scripter quelques effets sonores (la musique accélère quand le protagoniste est en danger) ou visuels (la caméra s’éloigne et/ou s’incline pour vous montrer le vide lorsque votre perso franchit un précipice). De même, on démultiplie les options de dialogues pour que les joueurs puissent se livrer à un peu de roleplay dans leurs interactions avec les PNJ, et on ramifie la fin des quêtes pour leur conférer de la souplesse, d’abord dans les événements mais jusque dans le sens que ces variantes de fin vont donner à l’ensemble d’une histoire. (La narration interactive devient d’ailleurs un sujet de recherche extrêmement sérieux, peu à peu financé par les éditeurs de jeu vidéo, et on en voit constamment progresser le fond comme la forme…)
Mais outre les limites du système-monde déjà évoquées, les ordinateurs ne savent toujours pas improviser ni retranscrire les infinies nuances du comportement humain, ils peinent encore à identifier les variations de sens d’une histoire et à en adapter la forme. De fait, sur la narration en particulier, rien ne vaut encore une bonne MJ capable de moduler ce qu’elle raconte pour réagir à ses joueurs, leur offrir une grande souplesse d’interaction et mettre en valeur leurs choix.
Parce que là où l’ordinateur ne peut que calculer, sélectionner et (progressivement) combiner des options pré-programmées, notre Meneuse de Jeu peut constamment inventer…
UN SYSTÈME-MONDE INFINI ?
Dans la famille Jeu de Rôles, le jeu vidéo est « celui qui a réussi » : à lui le pognon, l’attention médiatique et les garçons faciles. Mais, sans même considérer pour l’instant les interactions narratives, créatives et sociales entre les joueurs (que les MMORPG sont encore loin de vraiment exploiter, quoique moult évolutions soient possibles), le JdR sur table peut encore aujourd’hui proposer une expérience ludique et narrative très supérieure à son frangin informatique…
Premièrement parce qu’il est plus « essentiellement narratif« : parce que son support essentiel est encore cette fameuse parole performative, et à travers elle le plaisir et l’art très ancien de se raconter des histoires, le JdR est plus concentré sur la fiction, potentiellement bien plus riche dans sa narration, plus réactif et ‘narrativement’ plus interactif.
Deuxièmement parce qu’il est mécaniquement plus léger et plus souple : là où l’informatique doit coder, scripter, déployer, afficher et compiler la mécanique de jeu à travers une foule d’opérations complexes, le jeu analogique profite d’une hallucinante simplicité de moyens, puisqu’il tient essentiellement au langage. Il nous suffit de bien formuler les mécanismes pour qu’ils fonctionnent, ils nous suffit de bien les expliquer pour transmettre les règles explicites et esquisser le contour des règles implicites (mais encore faut-il faire l’effort : excusez-moi d’insister). Et il nous suffit même de raconter pour que l’histoire et la mise en scène s’adapte au gameplay.
Troisièmement parce qu’il est largement créatif (au point d’être souvent l’artiste incompris et anxieux de la famille), le JdR peut bénéficier de la simplicité de moyens sus-citée pour s’étendre à l’infini dans toutes les directions. On peut rapidement ajouter de la géographie au delà des frontières initiales, on peut modéliser presque instantanément des décors grandioses et insuffler la vie à des personnages crédibles. On peut développer le gameplay dans toutes les dimensions qu’on veut et même rien que dans la direction qu’on veut, au point même que les protagonistes puissent enfin influencer la marche du monde. On peut détailler les actions des joueurs avec un luxe de détails inconnu dans tout autre jeu, on peut adapter les challenges à l’humeur du moment, donc varier et moduler la difficulté à l’envie, on peut retoucher les règles explicites sur un simple accord verbal…
Et quand on a un peu réfléchi à nos concepts, on peut les faire advenir rien qu’en les disant.
[ VRAOUUUM !
Pour ceux qui ne se représenteraient pas bien la liberté créative et l’aisance technique qu’une telle virtualité génère, rappelez-vous mon histoire de bagnole de l’article précédent : imaginez maintenant que vous puissiez faire apparaître et même fonctionner le véhicule de vos rêves par le seul pouvoir du Verbe (et quelques images) ! Vous inventez un bolide et, dès que vous avez fini de le décrire, vous pouvez monter dedans, embarquer les postes et démarrer en trombe !!
Moi, chaque fois que j’esquisse le châssis d’un engin ludique, ça me colle le frisson… ]
Quatrièmement et finalement, parce qu’il est géré par une humaine, le JdR est carrément vivant. Excusez du peu !
En plus de conférer son pouvoir créatif et sa finesse de compréhension au système-monde, en plus de permettre un incroyable niveau d’interaction et de pouvoir moduler la narration avec une extrême subtilité, la Meneuse de Jeu réagit aux joueurs. Il vous suffit en fait de lui parler pour engager l’interaction, faisant d’elle l’interface de jeu la plus intuitive et la plus riche qu’on ait encore jamais conçue !
Et même si ses capacités effectives sont limitées par son savoir faire, vous pouvez même être sympa avec elle pour la motiver, la nourrir de vos émotions pour guider son action et enrichir la narration !
Alors qu’on a tous essayé d’encourager, supplier et engueuler l’ordi pour améliorer la jouabilité, et on sait bien que ça marche pas…
En théorie, le jeu de rôle sur table est donc rien moins que l’expression ultime du système-monde et de la narration interactive. À mes yeux, c’est le plus puissant, le plus vaste et le plus beau de tous les jeux : voilà, c’est dit.
Mais si je suis obligé de préciser « en théorie » (et croyez bien qu’à ces mots mon cœur saigne), c’est parce qu’en pratique, il semble communément admis que toutes ces merveilles conceptuelles soient abandonnées au hasard…
Dans notre série d’articles Jeter les dés ne me suffit plus, après l’introduction Pourquoi le gameplay est important et la première partie Définir le gameplay, voici la deuxième partie…
Maintenant qu’on a établi quelques bases concernant la nature des jeux, leurs règles explicites et implicites, leur mécanique et la situation du gameplay comme « usage du jeu », on va pouvoir approfondir et préciser la notion en se penchant justement sur certains de ses paramètres caractéristiques…
GAMEPLAY NON-LINÉAIRE
Si le gameplay suppose donc la déduction des règles implicites d’un jeu à partir de ses règles explicites, ça laisse pas mal de marge de manœuvre aux petits malins…
Par exemple, les règles explicites des échecs ne couvrent que le déplacement des pièces et les conditions de victoire, tenant grossièrement en deux pages. Mais il existe des bouquins entiers pleins de règles implicites, de l’importance de calculer les coups à l’avance jusqu’à la manipulation de l’adversaire en passant par les nombreuses stratégies disponibles.
Si le jeu d’échecs est ainsi extrêmement profond, c’est à dire qu’il recèle des trésors de règles implicites, son gameplay est pourtant dit « linéaire », c’est à dire que les mécanismes sont apparents, très réduits (tout ce que vous pouvez y faire est encore de bouger vos pièces) et -surtout- présentent constamment le même type de challenge : basiquement, calculer plus loin que l’adversaire.
À l’inverse, on commence à parler de gameplay « non-linéaire« , lorsque le but du jeu peut être atteint de manières assez variées pour que les joueurs puissent y choisir les challenges qu’ils veulent ou ne veulent pas relever. Ainsi, un Livre dont Vous Êtes le Héros qui permettrait vraiment d’atteindre la fin non seulement par des parcourts distincts mais en rencontrant des épreuves vraiment différentes pourrait revendiquer un gameplay non-linéaire. C’est aussi, dans une certaine mesure, le cas des wargames qui vous permettent de composer librement votre armée pour ensuite déterminer votre stratégie face à l’adversaire, en choisissant où et comment affronter ses propres troupes à travers un champs de bataille plein de possibilités (le tout encadré par de gros bouquins plein de règles explicites).
Mais la non-linéarité est surtout l’apanage des jeux vidéos plein de mécanismes complexes (que les règles explicites ne couvrent que très partiellement) et qui vous permettent d’aborder leurs différents challenges dans l’ordre de votre choix et selon des approches très libres. Ainsi les RPG de baston « open-world » vous permettent de nettoyer les donjons à coups de massue, en préparant une séquences de sortilèges finement optimisée, en rôdant furtivement jusqu’à poignarder des ennemis choisis ou carrément en attirant les monstres vers une ville dont les gardes feront le travail à votre place.
C’est cette richesse mécanique qui donne alors sa profondeur au jeu, mais aussi sa variété : si tous ces mécanismes, explicites et implicites, sont effectivement exploités par les concepteurs, alors leurs interactions peuvent générer une grande richesse de challenges, une grande variété de gameplay.
Dans cette optique, le JdR sur table serait le parangon du gameplay non-linaire, puisqu’en théorie vous êtes absolument libre de la manière dont vous abordez les obstacles et que toutes les actions imaginables peuvent être tentées… même si, en pratique, c’est hautement discutable (et croyez-moi, on y reviendra).
GAMEPLAY ÉMERGEANT
Différemment, le gameplay dit « émergeant » repose sur l’écart entre règles explicites et mécanismes implicites, et plus particulièrement sur toutes les combinaisons de règles que vont pouvoir inventer les joueurs au fur et à mesure qu’ils comprennent les mécanismes sous-jacents du jeu. Plus la pratique d’un jeu repose en fait sur les interactions complexes entre des mécanismes plutôt clairs, plus il permet aux joueurs d’en ré-inventer l’usage : c’est justement ce phénomène créatif de la part des joueurs qui fait émerger un nouveau gameplay, dépassant de loin les règles explicites.
Par exemple, Magic : the Gathering est un jeu de cartes avec déjà plein de règles inscrites sur les cartes (vendues séparément dans des paquets scellés) mais qui permet une myriade de combinaisons, découvertes à force d’achat compulsif et/ou inventées par des générations de joueurs : si les cartes contiennent des règles explicites, les nombreuses stratégies combinatoires et les tactiques momentanées qu’elles permettent sont très largement implicites (au point de n’être pas toujours bien anticipées par les concepteurs).
De la même manière, les dernières versions de Donjons & Dragons contiennent des dizaines de pages de règles de combat (explicites) qui permettent une foultitude de combinaisons implicites. Elles produisent dès lors un jeu de combat tactique très largement émergeant, puisqu’il permet aux joueurs d’inventer mille manières de meuler du monstre, et même de développer pour leur perso des approches très spécialisées de ce combat, qui représente en fait l’essentiel du jeu.
LE CHOIX
Au fur et à mesure qu’on creuse la notion, les choix et même la créativité ludique m’apparaissent donc comme des aspects importants du gameplay. Pour être exact, j’y vois une dimension ludique supplémentaire : au-delà de jouer à un jeu, on peut jouer avec. On peut interagir non seulement dans le cadre des règles mais aussi sur ce cadre de règles : en découvrir la profondeur implicite, prendre appui sur ce cadre pour imprimer une poussée au gameplay et développer par le jeu, plus exactement par l’usage du jeu, de nouveaux aspects, de nouvelles pratiques, de nouvelles conceptions d’un jeu.
C’est alors que le Jeu complet (avec majuscule) se révèle comme étant effectivement la somme de ses règles explicites, de ses mécanismes implicites et des pratiques potentiellement très variées, parfois très développées ou franchement détournées que les joueurs ont du jeu « de base ». Même si le jeu reste définit et formalisé par les règles, l’usage du jeu dépasse parfois de très loin le cadre apparemment étroit du livret de règles.
Sans s’aventurer trop loin dans le game-design, on peut déjà dire que cette liberté d’usage accordée aux joueurs est un des critères de qualité du gameplay : ce n’est évidemment pas le seul (on a déjà parlé de la richesse/variété des possibilités d’action, de l’éventuelle profondeur conceptuelle d’un jeu, on évoquera beaucoup par la suite sa cohérence…).
Pour autant, la liberté ne s’exprime que par les choix et, dans le cadre d’un jeu, ces choix doivent justement être intégrés à la mécanique ludique sous formes d’options.
Quand on conçoit un jeu, il faut donc prévoir et même informer ces choix, c’est à dire fournir aux joueurs assez d’informations pour faire un « vrai choix » parmi les options que propose le jeu (la plupart du temps, on préfère un choix conscient et rationnel mais, spécialement dans les jeux narratifs, un choix moral ou émotionnel peut aussi bien faire l’affaire).
Sauf qu’il existe différents types et différentes qualités de choix : selon les options mais aussi suivant le contexte global du jeu ou des situations ludiques ponctuelles, on peut parfaitement être confrontés à des choix pourris ou engageants (suivant la valeur qu’on accorde aux différentes options proposées), des choix tactiques (qui influencent une opposition ponctuelle) ou stratégiques (qui ont des conséquences à plus grandes échelles), des choix cornéliens (quand toutes les options sont non seulement mauvaises mais dramatiques), des choix subtils ou drastiques, sérieux ou rigolos… Et s’ils seront toujours définis au sein du jeu par un certain panel d’options (qui ont déjà valeurs de règles explicites), le sens de ses choix dépendra en fait largement du contexte ludique, donc d’abord du cadre global et du ‘but du jeu’, des challenges ponctuels, de l’éventuel contrôle que ces choix nous donnent sur la suite, mais aussi du rapport personnel du joueur à l’ensemble du jeu.
Par exemple, dans un combat difficile, rien que prendre le risque d’attaquer ou rester sur la défensive n’a pas la même valeur ludique et ne produit pas la même impression chez un joueur selon qu’il a des wagons d’unités à sacrifier ou un seul personnage-joueur auquel il est attaché. L’enjeu n’est déjà pas le même si la défaite implique au pire de recharger une sauvegarde ou si elle signifie la mort définitive d’un protagoniste. Le risque est varie selon la manière dont on évalue les chances de réussite des deux options proposées. Et notre approche de l’enjeu et du risque seront différentes suivant qu’on a le temps de peser nos décisions ou qu’on est pressé par l’urgence.
C’est ce qui fait dire à Sid Meyer (créateur de la série Civilization et grand-papy du jeu vidéo) que « le gameplay est une série de choix intéressants ». L’intérêt d’un choix va évidemment varier très largement selon le contexte de jeu, mais l’idée est qu’on s’investit dans un jeu notamment parce qu’il nous permet d’y exercer notre libre-arbitre, et qu’il pique notre curiosité en suggérant des conséquences possibles à nos décisions, qui vont à leur tour se traduire par de nouveaux choix.
C’est effectivement une grande part du gameplay des jeux conçus par Meyer : on y passe notre temps à choisir des options qui détermineront les challenges à venir et les options suivantes, redéfinissant constamment le champ des possibilités. Pour le coup, c’est vraiment une manière de jouer avec le jeu, en approfondissant constamment notre compréhension de la mécanique, en écartant certains challenges pour en faire apparaître de nouveaux et donc en faisant évoluer l’usage du jeu. Mais, face à des jeux aussi mouvants, encore faut-il qu’on comprenne ce qu’on est en train de foutre…
JOUABILITÉ ?
Les premiers critiques de jeux vidéo francophones ont, dès les années 80, accouché d’une notion assez cousine, pourtant distincte mais qu’on a longtemps confondu avec une traduction de gameplay : la jouabilité.
Si elle touche un peu aux possibilités d’action offertes par un jeu, la jouabilité est essentiellement une question d’ergonomie : avec quelle aisance ou quelle difficulté peut-on effectivement utiliser un jeu, apprendre à manier ses commandes et, donc, effectivement jouer avec. Ce qui n’était pas du tout une question anodine à l’époque où on s’usait les paluches sur des « joysticks » trop mous et des manettes anguleuses, même si l’on ne l’aborde plus aujourd’hui que lorsqu’un jeu vidéo a vraiment des commandes trop chiantes (c’est à dire déjà bien plus faciles qu’il y a 30 ans).
La jouabilité est pourtant une question qui devrait nous préoccuper en JdR, puisque notre loisir pose de sérieux problèmes d’accessibilité et d’apprentissage : non seulement parce qu’on s’échine encore à assommer les lecteurs avec des bouquins de 400 pages qui, fatalement, rebutent une large part du public potentiel, mais aussi parce qu’on a pas fini de se débattre avec les règles mal expliquées et les systèmes intrinsèquement imbitables. Car si les tables logarithmiques ont heureusement disparus des JdR modernes, quand on voit qu’un JdR « grand public » comme D&D implique de maîtriser facilement dix fois plus de règles (explicites) que la majorité des jeux vidéos, alors que les rôlistes s’émerveillent encore qu’un résumé des règles apparaisse par miracle sur leur fiche de perso, on sent bien qu’on est pas encore sortis de l’auberge…
Bien au-delà de l’accessibilité du loisir en général, le rapport aux règles de la plupart des JdR m’apparaît comme un putain de gros problème pour les rôlistes eux-mêmes : parce que si le JdR revendique constamment l’immense liberté qu’il offre à ses pratiquants, c’est oublier qu’un joueur ne peut en réalité y faire que ce qu’il sait être possible, et bien souvent seulement ce qu’il sait comment entreprendre. En clair : quelles que soient les possibilités théoriques d’un JdR, dans la pratique, on ne peut vraiment jouer, au mieux, qu’avec les bouts qu’on a compris.
Et à cet égard, nombre d’auteurs de JdR semblent encore considérer que « la MJ s’en démerdera » : apparemment, c’est à leur principale cliente, celle qui a le plus souvent payé le bouquin, de faire en plus l’effort de comprendre et d’expliquer aux autres utilisateurs -ses joueurs- tout ce que les auteurs n’ont pas eu le temps ou la motivation de clarifier. C’est tellement habituel en JdR que ça ne choque plus personne, mais comparons avec notre grand cousin le jeu de société : dans le livret de règles des Colons de Catane, on trouve déjà considérablement moins de règles que dans la majorité des JdR, ces règles s’appuient sur bien plus de supports tangibles (pions, tuiles, marqueurs…), elles sont néanmoins rédigées avec un évident souci de clarté (elles ont notamment été relues et testées en ce sens), la maquette s’échine encore à aérer le tout en nous fournissant de petits schémas quand ça devient trop abstrait… et tout ça pour un jeu dont la complexité, la subtilité et la virtualité restent très inférieures à celles du JdR.
Inversement, chez les rôlistes, des concepts autrement plus tordus, exprimés par des règles sensiblement plus compliquées, le tout soutenant une expérience ludique autrement plus exigeante sont généralement exposés avec une approximation dommageable et une mise en forme qu’on emploie même plus pour les feuilles d’impôts. La plupart du temps, y a même pas de pions pour les points de vie. Pourquoi ?!? Là encore : croyez bien qu’on y reviendra par la suite…
Outre que cette attitude est complètement délirante d’un point de vue industriel et commercial (imaginez le marché du jeu de société si on s’y prenait avec la même négligence), elle pose des questions intéressantes, du point de vue du game-design comme du gameplay…
Avant tout, ça veut dire que la jouabilité limite strictement le gameplay : elle est la mesure inférieure de « l’expérience-utilisateur » si chère au jeu vidéo, et le minimum syndical pour seulement avoir accès au jeu. Quand on conçoit un JdR, on devrait donc à un moment se préoccuper de l’accessibilité d’une part, en particulier faciliter l’acquisition et l’apprentissage du jeu par ceux qui le découvrent (tout spécialement dans un média « indirect », où une première lectrice-MJ est en charge d’expliquer le bousin aux copains), et de l’interface de jeu d’autre part : quels supports va-t-on fournir à nos utilisateurs pour qu’ils puissent jouer clairement et agréablement ?
C’est le genre de réflexions qui pourraient informer, entre autres, la conception des fiches de personnage (qui devraient être d’avantage un « tableau de bord » qu’un récapitulatif de la création de perso), la lisibilité des cartes et dés spéciaux, le design des écrans de MJ (qui regroupent généralement tout plein de règles et pas la moindre indication sur la manière de mener le jeu), les plateaux tactiques le cas échéant et les fameux résumés de règles à l’usage des joueurs : des aspects généralement si peu investis par les concepteurs que dans la plupart des JdR, lorsque vous incarnez autre chose qu’un combattant, la majorité des infos utiles sont reléguées au verso ou dans les pages suivantes.
Sans déconner : il a apparemment fallu attendre l’Apocalypse (en tous cas les jeux « propulsés par… ») pour que des fiches listent clairement les actions spécifiques au perso, et j’attends encore le système de jeu qui me fournira enfin une double-page « comment expliquer tout ça à vos joueurs ». Parce que rien que la transmission aux joueurs des règles implicites est déjà un vrai problème pour tous les #¤%µ& de jeux qu’on nous vend et que, encore une fois, ce que les joueurs percutent de leurs possibilités limite strictement le gameplay global.
Avec d’aussi hautes prétentions ludiques (gameplay non-linéaire, émergeant, évolutif…) sur lesquels on empile encore des exigences narratives, comment se fait-il que le JdR déploie si peu de moyens pour seulement s’expliquer ?
SYNTHÈSE PERSONNELLE
Tout ça m’amène à MA définition du gameplay, avec laquelle vous n’êtes pas obligés d’être d’accord mais sur laquelle j’ai un peu planché, et dont j’use principalement pour concevoir des systèmes (et parfois médire de ceux des autres).
Si le gameplay est l’usage du jeu, alors cet usage doit nécessairement considérer le fameux but du jeu, qui donne sens à l’ensemble et focalise les possibilités d’action. (Le « but du jeu de rôles » est néanmoins une question compliquée, à laquelle je reviendrai dans la suite.)
Dans l’absolu, ce but peut servir à catégoriser les jeux, de même que les types et le niveau de challenges qu’ils proposent : tout ça compose l’argument du jeu, ce à quoi on joue, normalement clairement énoncé dans les règles explicites du jeu, qui en définissent alors le cadre et les principes fondamentaux.
À mes yeux, le gameplay commence juste au-delà de cette base : dès la découverte d’un jeu, tout le long de son apprentissage, quand on se contente de respecter les règles écrites comme lorsqu’on explore les mécanismes implicites, à travers les sensations et les émotions que procure l’activité, au fil de tout ce qu’on invente, développe et même détourne à l’intérieur du cadre ludique, on est encore dans l’usage, dans la pratique du jeu.
Et tous les éléments de cet usage pour peu qu’ils se produisent pendant les parties et participent cette pratique, appartiennent selon moi au gameplay. En bref, si les règles et leurs supports déterminent la matière du jeu, le gameplay n’est rien moins que l’ensemble des interactions dans le jeu, avec le jeu lui-même comme avec les autres joueurs.
Selon la richesse de la matière ludique de départ, le gameplay est donc un machin potentiellement énorme, protéiforme et même subjectif : quoique jouant ensemble, deux joueurs distincts peuvent ne pas jouer du tout de la même façon (ils en comprennent et utilisent des aspects différents, en tirent des impressions divergentes et ne s’investissent pas au même niveau), donc expérimenter respectivement des gameplays différents dans le cadre d’un même jeu.
Histoire d’analyser ce cadre et de s’y situer, on pourrait d’ailleurs mesurer l’ampleur d’un gameplay selon trois dimensions, dont les règles explicites fixeraient les bords :
● sa « largeur » indiquerait la diversité de ses mécanismes et la variété de ses challenges, permettant des alternatives de gameplays plus ou moins nombreuses,
● sa « hauteur » traduirait sa difficulté, le niveau du challenge et ses exigences techniques (adresse, rapidité, réflexion, connaissances, créativité…), le tout potentiellement adouci ou durci par la fameuse jouabilité,
● sa « profondeur » représenterait enfin la complexité et l’étendue des mécanismes implicites, donc la part de découverte, d’appropriation et même de développement laissée aux joueurs.
Certains aspects appartiendraient alors clairement à une dimension plutôt qu’une autre : les embranchements d’une histoire interactive participeraient de sa largeur quand la montée progressive du challenge influence sa hauteur totale (mais on pourrait donc parler de gameplay plus ou moins « pentu »). Inversement, d’autres éléments se situeraient à la croisée de plusieurs dimensions : la liberté d’interaction offerte aux joueurs, notamment, dépendrait d’abord de la largeur (variété des options) mais aussi de la profondeur du jeu (possibilités de découverte, de détournement).
Et bien sûr, le croisement des dimensions créerait des coordonnées, peut-être même une manière de se positionner dans le « volume ludique »… 
Mais je mets tout cela au conditionnel car ce n’est qu’une représentation possible (et qui m’amuse) de la quantité de gameplay disponible dans un jeu, donc la taille de l’espace interactif qu’il crée. Et, en soi, ça ne traduit pas encore la qualité d’un gameplay : celle-ci risque d’être aussi subjective que peut l’être l’expérience ludique de différents joueurs ou les ambitions créatives des concepteurs, mais la question qualitative va nous amener doucement vers la notion d’agentivité, qui est justement le sujet de l’article suivant…
Dans notre série d’articles Jeter les dés ne me suffit plus, après l’introduction Pourquoi le gameplay est important, voici la première partie…
Le mot lui-même est au départ le substantif (la transformation en nom commun) de « How the game plays », qui fut longtemps le titre des modes d’emploi de jeux d’arcade. C’est la petite notice qui, avant de jouer, vous disait sur quels boutons appuyer pour déplacer votre bonhomme et meuler les ennemis.
Mais cette origine est intéressante au delà de l’étymologie et de l’histoire des jeux : c’est vraiment la formulation la plus fondamentale non seulement du « but du jeu » , mais aussi des moyens à votre disposition pour en relever le challenge. Et le lexique employé autour de la notion de gameplay amène déjà plein de réflexions bien juteuses, mais surtout nécessaires vus nos problèmes de vocabulaire…
Car vous aurez sans doute remarqué que causer de JdR est difficile.
Bien souvent, les discussions se vautrent dans des débats sur le sens des mots avant de s’attaquer vraiment aux idées, tout simplement parce que les rôlistes ne partagent pas assez de vocabulaire commun pour parler clairement de leur loisir. C’est pas complètement de leur faute, non plus : les différentes réflexions sur le jeu se heurtent toutes, en Français encore plus qu’en Anglais, à l’absence d’un lexique transversal clair.
Les galères lexicales empirent nettement dès qu’on se penche sur des jeux complexes (avec plein de paramètres), subtils (plein de finesses et de nuances) ou virtuels (c’est à dire dématérialisés, libérés des supports tangibles et donc vachement plus difficiles à circonscrire).
Le JdR étant tout à la fois complexe, subtil et virtuel, c’est carrément la merde : parce qu’il nécessiterait de nommer et de définir un gros paquet de concepts. D’ici qu’on produise un lexique rôliste un peu large (sinon exhaustif) et communément admis (c’est pas gagné), on est donc contraints de se démerder en empruntant du vocabulaire à divers domaines connexes comme à l’Anglais, et en établissant des définitions temporaires rien que pour commencer à discuter.
C’est exactement ce que je vais faire ici : tâcher de produire une définition provisoire du gameplay, pour pouvoir ensuite réfléchir et discuter ses usages rôlistes. Et si au passage ça donne à certains de mes lecteurs envie de me contredire et de proposer autre chose, tant mieux.
Pourvu que la conversation ait lieu…
DÉFINITIONS MULTIPLES
Avouons-le tout de suite, il y a déjà plein de définitions du gameplay rien qu’en Anglais. Elles ne sont pas toutes concurrentes, la plupart se recouvrent en grande partie et certaines ont simplement des usages différents dans des contextes distincts (les jeux « en général », les jeux vidéos, les jeux publicitaires…). Pour affirmer leurs approches respectives, nombre de concepteurs de jeu en ont aussi énoncé leur version personnelle (je vais m’y commettre aussi, évidemment).
Il y a heureusement un peu de consensus sur ce que le gameplay est sensé recouvrir : non pas la mécanique de jeu ou son design, mais bien l’usage du jeu. Ça ne définit pas encore grand-chose, mais ça permet de situer le concept.
Disons pour l’instant que le gameplay est au jeu ce que la conduite est à la bagnole : on a pas besoin de regarder sous le capot pour conduire, mais le pilotage implique d’au moins comprendre comment marche l’engin, les effets qu’il produit et donc les diverses possibilités d’utilisation. Et si on commence à vouloir bricoler sa caisse ou même à en concevoir une nouvelle, il va justement falloir se préoccuper de la conduite autant que de la mécanique.
Au fond, qu’on parle de véhicules automobiles ou ludiques, ceux qui les construisent comme ceux qui les utilisent doivent toujours se demander ce que le bousin peut faire et comment s’en servir. Mais pas que…
Cette approche par l’usage amène certains à définir le gameplay comme « les possibilités d’action qu’offre un jeu ». Ça a le mérite de préciser un peu le concept et de caractériser ce panel de possibilités : on peut ainsi parler de gameplays plus ou moins riches ou pauvres, simples ou complexes, diversifiés ou étroitement cohérents.
Sauf qu’une liste de possibilités, même une liste commentée, ne suffit pas à décrire une expérience ludique : si je vous dis que le jeu vous permet de lancer une boule de toutes les manières que vous voulez mais sans dépasser la ligne en bout de piste, ça ne vous indique même pas si on joue au bowling ou à la pétanque.
Pour savoir à quoi on joue, il faut encore que ce panel de possibilités servent un objectif global, et là coup de bol, ça a déjà un nom : le « but du jeu » …
Ce but du jeu est une notion fondamentale pour définir une activité ludique puisque c’est non seulement ce qui en caractérise la finalité, ce qu’il faut atteindre pour gagner (et qui par contraste détermine aussi la défaite), mais c’est plus largement ce qui donne un sens au jeu (ce n’est donc pas un hasard si ce but est la première chose qu’expliquent la plupart des livrets de règles… mais on reviendra sur les règles un peu plus loin).
Et ce sens est indispensable tant pour identifier un jeu parmi d’autres que pour en examiner la pratique et les mécanismes. Autant on sait grossièrement à quoi sert une bagnole (se déplacer en faisant vroooum), autant notre véhicule ludique peut avoir des formes, des capacités et donc des usages terriblement variés. D’abord parce que les jeux sont des objets largement virtuels, donc extrêmement protéiformes et abstraits, ensuite parce qu’ils servent une fonction générale franchement nébuleuse : jouer ou, encore plus vague, « s’amuser ».
Dans ce grand flou, la définition d’un jeu spécifique va donc s’appuyer sur une fonction précisée d’abord par le type de challenges qu’il propose -un jeu de stratégie, un jeu d’adresse, un puzzle- puis souvent par un support, histoire d’échapper un peu à l’abstraction : jeu de plateau, jeu de cartes, jeu vidéo…
(Je trouve alors intéressant qu’un jeu « de société » décrive à la fois un type de challenge, puisque il implique déjà la compétition entre les joueurs, et une forme particulière de support : pour chaque participant, les autres vont aussi représenter des ressorts ludiques ! Mais je m’égare…)
Quand on a ainsi circonscrit une sorte de périmètre où situer notre jeu, on peut alors préciser sa définition par ce fameux but, qui induit souvent des moyens : le Monopoly comme le Risk sont des jeux de stratégie (et même de conquête) sur un plateau, mais le but du premier consiste à ruiner ses adversaires (donc le jeu va largement reposer sur le pognon) quand le but du second est d’envahir « militairement » une portion variable de la carte (donc il y aura du combat et des pions pour situer les armées sur la carte).
Ce n’est finalement que dans le cadre définit par un « type » de jeu, après avoir établi un « but du jeu », que la question du gameplay commence à faire sens… mais bien sûr, on va identifier de nouveaux problèmes dès qu’on se posera la question du « but du jeu de rôles » (on y reviendra dans l’article 5).
De fait, nombres de définitions du gameplay s’approchent en fait de la notion de genre ludique, une sorte de typologie établissant des catégories à la fois par le but d’un jeu, les challenges qu’il favorise et -enfin- par la manière dont on y joue :
en jeu vidéo, un traversal, un plateformer ou un runner ont tous pour but d’arriver au bout d’un parcours périlleux et mettent en valeur l’adresse du joueur au cours de la circulation dans un décor dangereux (parce qu’on peut tomber ou se planter dans les obstacles) ; un jeu de stratégie ‘en temps réel‘ se distingue de son cousin ‘tour par tour‘ dans ce que le premier repose sur l’optimisation du temps de développement et déploiement des armées (gestion ‘macro’) quand le second est d’avantage affaire de combinaisons et de programmation des actions (gestion ‘micro’) ; rien que les nombreux FPS sont divisés entre les jeux solo, en équipe, coopératifs (contre l’ordinateur) ou compétitifs (contre d’autres joueurs).
De même , des JdR sont parfois décrits comme des jeux d’ambiance (axés sur la mise en scène et le roleplay), d’intrigues (complots, investigations et subterfuges), d’aventure (exotisme et action échevelée) ou tactiques (plein d’options pour bastonner). J’en retiens surtout que, indépendamment de l’univers fictif dans lequel ils sont installés et au-delà du fait que la plupart des JdR revendiquent une grande liberté d’action, nos jeux se définissent déjà par ce qu’on va y faire le plus souvent et le genre de challenges qu’ils proposent.
Pour certains, le gameplay devrait aussi tenir compte de la difficulté : le fait qu’un jeu soit facile ou ardu influence en effet grandement le type d’expérience qu’il présente, qu’il offre simplement de se détendre, qu’il demande un peu de concentration pour en profiter pleinement ou qu’il exige un gros investissement pour vaincre un challenge élevé.
Par exemple, parmi les jeux vidéo de dungeon-crawl où l’on déglingue du streum pour rafler du butin et bricoler ses armes, la série des Torchlight propose une expérience ludique extrêmement éloignée de celle des Dark Souls : là où le premier vous propose de cliquer gaiement sur des monstres toonesques pour déverser des tombereaux de loot, le second exige que vous passiez des plombes à optimiser votre tactique pendant qu’il s’acharne à avoir votre peau. Et ce rapport au challenge les distingue bien plus encore que leurs choix de perspectives, d’esthétiques ou de scénario.
Cette distinction me paraît applicable en JdR puisque, dans le même genre fictionnel de »l’occulte contemporain », un jeu comme In Nomine Satanis/Magna Veritas propose principalement de déconner avec les concepts religieux quand une campagne de Nephilim exige que vous appreniez tout un corpus ésotérique avant de commencer à résoudre des énigmes millénaires. Là encore, si les deux jeux se distinguent en fait de milles manières, c’est encore le niveau d’exigence qui les sépare le plus à mes yeux : contrairement à INS, on ne peut pas se faire « un petit Nephilim vite-fait pour rigoler« .
[ LES MOTS & LE VIRTUEL
La plupart des jeux s’appuient et sont transmis (donc notamment commercialisés) via des supports tangibles, du très volatile multi-média aux bonnes vieilles figurines en passant par les livres de règles (papier ou numérique), les cartes, les plateaux, les manettes, les dés et tous les autres machins qui servent à matérialiser ces jeux pour qu’on puisse les manipuler physiquement. Mais une des difficultés à les concevoir et à en parler réside dans leur grande virtualité. Parce qu’en fait, les jeux sont fondamentalement composés de règles et réalisés par la pratique, par l’usage que les joueurs font de ces règles : les pixels et les bouts de cartons ne sont que des formes données à certains mécanismes de jeu.
Les règles sont par nature ‘virtuelles’ parce qu’elles sont des concepts, des idées, qui contrairement aux lois physiques n’existent que dans nos têtes. Alors la réalisation de ces règles, leur apparition dans le monde tangible se fait principalement par le langage : on les énonce, on les mets en mots, on les écrits parfois, elles font sens dans nos têtes et, dès lors, elles existent, et ont peut les transmettre à d’autres gens.
C’est particulièrement sensible quand vous jouez aux devinettes et à tous les jeux qui, dans notre culture, n’existent que par le langage : ça suffit déjà pour énoncer des règles, induire des principes (parfois presque des mécanismes), interagir avec ces règles et donc jouer. Si on veut élaborer un peu, les règles d’un jeu peuvent en fait s’incarner dans des langages assez différents (notamment mathématiques, symboliques et visuels), mais c’est encore essentiellement par la langue, écrite ou parlée, qu’on manifeste la pensée (y compris dans notre propre tête).
C’est éminemment pratique, c’est presque magique ce pouvoir des mots sur le virtuel, mais ça complique sévèrement les discussions sur le jeu. Parce que les règles s’incarnent dans le sens des mots, il suffit déjà qu’on utilise pas les bons termes pour brouiller la compréhension des règles (on s’en rend bien compte quand on rédige un manuel de jeu). Pire encore, quand on utilisent pas tous les mêmes définitions, parler du virtuel -en l’occurrence du jeu- devient un merdier sans nom puisque les mots et leur sens donnent formes à ces notions dans nos têtes.
C’est un peu comme de s’échanger des pièces de puzzle rien qu’en les décrivant : si les termes que j’emploie pour un concept génère, dans l’esprit de mon interlocuteur, une pièce différente de celle que j’imaginais, on va vraiment galérer à emboîter notre puzzle commun.
Et quand les deux phénomènes se croisent, c’est à dire d’une part que les mots définissent les règles et d’autres part qu’ils donnent également forme aux notions, rien que le fait de parler d’un jeu peut commencer à déformer le jeu. Ça, c’est vraiment la malédiction des discussions rôlistes… mais ce n’est peut-être pas une fatalité. ]
RÈGLES, MÉCANIQUE & FORMES DU JEU
Si le gameplay est grossièrement défini comme « ce à quoi on joue et comment« , on est vite tenté de répondre « on joue selon les règles« . C’est un peu réducteur, mais c’est pas faux…
Si un jeu est caractérisé par son but, les règles viennent encadrer les manières dont on peut l’atteindre : elles définissent en gros ce qu’on a le droit et pas le droit de faire dans ce but. Dans beaucoup de jeux « analogiques » (par opposition aux jeux numériques), ceux qui ont donc un support matériel en papier, carton et autres pions en plastique, les règles sont notoirement « écrites », c’est à dire transmises par du texte. Mais ces règles écrites ne sont pas le jeu : elles n’en sont qu’une manifestation, une mise en forme. (Et généralement même pas la seule : le plateau, les cartes, les pions, les compteurs sont tous des formes tangibles données à certains aspects du jeu.)
Et c’est là qu’il faut être très attentif car la confusion courante entre le fond et la forme pose des problèmes assez sévères en « ludologie », quand on essaye de comprendre la nature, le fonctionnement et les formes d’un jeu…
D’abord, les règles écrites, données à lire aux utilisateurs, ne doivent pas être confondues avec la mécanique de jeu. Un livret de règles ne décrit pas plus la mécanique d’un jeu que le manuel d’une bagnole ne vous explique le moteur à explosion : dans les deux cas, le texte ne transmet vraiment à l’utilisateur que ce qu’il est sensé faire avec l’engin, pas son fonctionnement interne.
La nuance peut paraître subtile à un utilisateur, puisque le manuel contient sensément tout ce qu’il a besoin de savoir (au moins tant que l’engin fonctionne), mais elle est fondamentale pour un concepteur et, dans un jeu, elle commence à apparaître dès que des effets ‘mécaniques’ se manifestent sans que les règles les aient mentionnés. Ce qui est en fait assez courant…
Par exemple, les règles écrites du jeu de dames disent que le perdant est celui dont tous les pions ont été retirés du damier, mais elles ne vous préviennent pas que, au fur et à mesure que vous perdrez des pions, vos possibilités d’action vont se réduire drastiquement.
Elles ne vous disent pas non plus que le principal enjeu tactique est donc de tâcher de perdre moins de pions que l’adversaire, ni que la constante disparition des pions va pourtant ouvrir de nouvelles possibilités de déplacement. Encore moins que c’est le dégagement progressif du damier qui donnera tout leur intérêt aux « dames », dont la capacité de déplacement décuplée n’a guère de sens avant que le plateau se soit nettement éclairci. Et pourtant, cette spirale descendante du nombre de pions qui augmente la mobilité et les dames qui produisent une seconde phase de jeu, nettement accélérée, sont pourtant des mécanismes intrinsèques au jeu.
Simplement, les règles vous laisse les découvrir, et concevoir votre propre tactique.
[ GAME & PLAY
Puisque c’est le langage qui sert à transmettre les idées, une partie de nos problèmes conceptuelles viennent du fait qu’il n’existe en Français qu’un seul mot pour désigner deux notions bien distincte en Anglais : quand il parle d’un « jeu », le Français peut aussi bien faire référence à l’objet -déjà plus ou moins virtuel- que l’Anglais appelle « game » qu’à l’activité, le fait de jouer : « play ». L’addition des deux termes pour former « gameplay » est de fait assez révélatrice… ]
C’est encore plus sensible avec les jeux vidéos : il y a bien longtemps que les manuels de règles écrites en ont disparu, reste le tutoriel qui vous explique les commandes de base puis vous incite à quelques exercices de prise en main. Mais on ne vous explique ni la stratégie optimale à adopter ensuite, ni comment vous orienter dans l’espace, ni la mécanique d’application et de calcul des dommages sur le volume de collision des ennemis, ni la complexité du code qui fait tourner tout le joli monde en 3D autour de votre perso. Au-delà de quelques ‘règles de base’, souvent spécifiques à un jeu particulier, les concepteurs présupposent en fait que vous connaissez déjà les principes du médium (donc que vous saurez vous débrouiller des vues subjective ou à la troisième personne, vous approcher des monstres pour taper dessus, bidouiller les commandes si besoin…) et, surtout, que vous apprendrez le reste en jouant.
Hé bien figurez-vous qu’aux dames comme dans World of Warcraft, on vous cache une grande partie de la mécanique justement parce l’acquisition du jeu, la maîtrise progressive de son usage, repose sur le fait que vous découvriez vous-mêmes ce qui se cachent derrière les règles énoncées.
En réalité, le gameplay va plus loin que les règles explicites d’un jeu justement parce qu’il suppose l’apprentissage de ses règles implicites : celles qu’on ne vous racontent pas, et qui forment pourtant la plus grande partie de la mécanique de jeu.
Et si c’est aussi vrai en Jeu de Rôle, c’est un principe plus souvent appliqué au roleplay qu’à la mécanique ludique qui, elle, est très souvent apparente, mais sans profondeur (on y reviendra).
[ RÈGLES ≠ MÉCANISMES ?
Parce que le jeu est (donc) un domaine très largement virtuel, immatériel, il repose sur des mécanismes très largement abstraits, qui ne sont qu’en partie matérialisés par des règles énoncées (donc explicites) et différents supports tangibles (cartes, pions) ou sensibles (images, sons, rythmes…). Mais, à la limite, on peut considérer toute la mécanique comme un ensemble de règles : des règles mathématiques, des règles mécaniques, des règles informatiques… toutes relativement arbitraires, et qui participent toutes à définir un jeu.
Quoique les termes ‘règles’ et ‘mécanismes’ soient donc assez synonymes, pour me faciliter la vie (et peut-être votre lecture), je donne plus volontiers le nom de ‘mécanismes’ aux rouages abstraits et implicites du jeu, ce qui me paraît participer d’avantage de la ‘mécanique’, et j’appelle généralement ‘règles’ l’expression de certains de ces mécanismes dans des prescriptions explicites, soit souvent le manuel du jeu.
Mais bon, j’admets que c’est pas simple… ]
À ce stade, j’ai bien conscience d’avoir à peine entamé la définition du gameplay, mais comme ça fait déjà un gros pavé, coupons-là pour reprendre dans l’article suivant : Paramètres de gameplay & jouabilité.
Il est difficile de parler de gameplay en JdR.
Pour les francophones, le terme est déjà assez vague en lui-même, puisqu’il renvoie principalement au jeu vidéo : ainsi on le confond souvent avec la « jouabilité » (dont il est un faux-ami) et on perçoit rarement tout ce qu’il recouvre dans les jeux de cartes, de plateau et de narration.
Mais, surtout, comme la plupart des principes véritablement ‘rôlistes’, le gameplay des JdR se situe au point de rencontre du jeu et de la narration, des joueurs et des rôles : entre le tangible et l’intangible. Ainsi tacheté des deux couleurs du JdR, dissimulé parmi un tas d’autres concepts et lié à la plupart d’entre eux (genre fictionnel et genre ludique, système et mécanique de jeu, règles écrites et non-écrites, univers fictif, narration et scénario, personnages, fonctions du MJ, pouvoirs des joueurs et agentivité, challenges ludiques, supports de jeu…), le gameplay rôliste est un animal bien difficile à distinguer.
Ce n’est pourtant pas (seulement) par goût de la branlette intellectuelle que je m’en préoccupe ici. La transversalité même du concept donne une idée de son importance : si un machin touche à autant d’aspects du JdR, alors il ne peut pas être anodin. Et il ne l’est plus du tout dès qu’on résume la notion de gameplay en une question fondamentale :
à quoi on joue, et comment ?
Car cette question est au cœur de tous les jeux, et c’est la première à se poser pour savoir ce qu’on est vraiment en train de foutre. Lorsqu’on considère les jeux vidéo, ce n’est pas un hasard si les critiques, les analyses et les réflexions théoriques accordent autant d’importance au gameplay, ni s’il est le sujet de la moitié des vidéos promouvant les nouveaux jeux : c’est parce qu’au-delà des univers virtuels, des jolies zimages et des bribes d’histoires dont nous abreuvent les bandes-annonces et les teasers, au-delà des plate-formes, des avancées technologiques et des questions de business, quand on nous parle d’un jeu à paraître, la question qui nous intéresse vraiment est » comment ça se joue ? « .
Il me semble alors très étrange qu’on se la pose si peu en JdR.
Si j’aborde cette question par écrit, après l’avoir mentionnée dans différents podcasts (les Carnets Ludographiques #2 les Intentions Ludiques, #3 le Développement Ludique, #16 l’Enquête et plus particulièrement le Radio Roliste #53), c’est d’abord pour mettre mes propres idées à plat, évidemment. Mais aussi dans l’espoir que cette série d’articles puisse être plus facilement reprise ailleurs, critiquée et discutée, parce que l’écrit est de ce point de vue bien plus maniable que si mes réflexions sur le gameplay étaient restées morcelées dans plein de mp3.
Je tente ma chance contre cet animal conceptuel, si vous voulez : d’autres décideront ensuite si je l’ai capturé ou seulement entrevu…
Mais j’y vais pas à poils, non plus : je m’arme justement d’un paquet de concepts et de réflexions produites par tout plein d’auteurs, qui seront brièvement expliqués au fil des articles suivant. Quand bien-même je reviendrai bredouille de ma longue chasse au gameplay, ces articles seraient au moins une compilation de concepts utiles. (Mon sous-titre fait d’ailleurs référence au « System does matter. » de Ron Edwards et, à mes yeux, si les systèmes importent, c’est largement pour le gameplay qu’on peut en tirer.)
Notez que je vais régulièrement employer des concepts issus du jeu vidéo pour une raison très simple : dans le domaine de la recherche ludique, l’industrie qui brasse le plus de pognon est encore celle dont les théories avancent le plus vite…
Ceci n’était que l’introduction (tatatiiiin), voici la série d’articles :
► 1] Définir le gameplay
► 2] Paramètres de gameplay & jouabilité
► 3] L’agentivité & le système-monde
► 4] Au hasard des jeux
► 5] Où se cache le gameplay du JdR ? (à paraître)
► 6] Le gameplay du roleplay (à paraître)
Note : à travers l’ensemble de ces articles, je dirais « la Meneuse de Jeu » et « les joueurs ». Si ça vous défrise pour une raison ou une autre, il vous suffira d’avoir deux chromosomes X pour que je tienne compte de vos protestations.
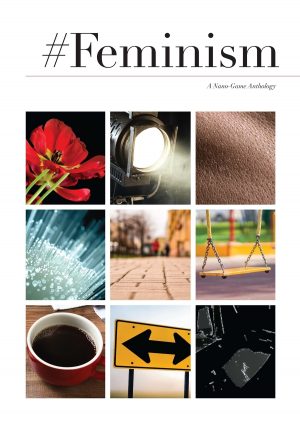 Au sommaire de ce numéro :
Au sommaire de ce numéro :
Les liens de ce numéro :
Les liens de ce numéro :
La troisième et dernière partie de ce gros podcast, qui traite finalement…
Notre numéro d’avril abordera -avec Le Grümph- le découpage de scénarios et la question subséquente des choix des joueurs : d’ici là, n’hésitez à nous poser vos questions (sur l’enquête ou le découpage) dans les commentaires !
Cette deuxième partie aborde notamment…
 Dans ce schéma en toile, les PJ abordent l’enquête par l’extérieur (cercle blanc) et se déplace le long de cercles concentriques croisant les différents thèmes de l’intrigue. Pour progresser vers la « vérité » (quelle qu’elle soit), ils doivent résoudre des challenges à la difficulté grandissante (du gentil jaune au redoutable rouge) afin d’obtenir les indices numérotés qui pointent vers le cercle suivant…
Dans ce schéma en toile, les PJ abordent l’enquête par l’extérieur (cercle blanc) et se déplace le long de cercles concentriques croisant les différents thèmes de l’intrigue. Pour progresser vers la « vérité » (quelle qu’elle soit), ils doivent résoudre des challenges à la difficulté grandissante (du gentil jaune au redoutable rouge) afin d’obtenir les indices numérotés qui pointent vers le cercle suivant…
Bien sûr, certains challenges et indices sont à la frontières de plusieurs thèmes, alors que le nombre d’épreuves (et d’accès possibles) se réduit au fur et à mesure qu’on progresse dans la compréhension des événements…
Et on reprend enfin notre rythme de publication normal avec ce très gros Carnet en trois parties, où Kobal et moi-même nous penchons longuement sur le jeu d’enquête : comment ça se conçoit, se joue et se met en scène, quels mécanismes mettent la notion en valeur, etc.
Cette première partie traite en particulier de…
Au sommaire de ce numéro :
Liens de ce numéro :
La campagne de Shaan.
Le site de Ross Cowman pour Fall of Magic / L’automne de la magie.
Pour télécharger Dark Cthulhu : en VO / en VF.
Des hacks de Dark Cthulhu :
– Ghosts of Opal Ditch.
– Star Wars: the Dark Times.
– Dark Ronin.
– Ghost Lines Dark.
– So Now You’re a Time Traveller.
– Plein d’autres mécaniques de hack plus ou moins abouties ici !
Et voici un nouveau Carnet sur « l’Art d’être Joueur », concernant cette fois la manière de formuler, discuter et négocier les apports multiples autour d’une table de jeu. Julien et Sébastien discutent entre autres…
Vous trouverez sur leur blog respectif l’article de Vivien Féasson et la série d’Eugénie cités durant le podcast.
Bonne écoute !